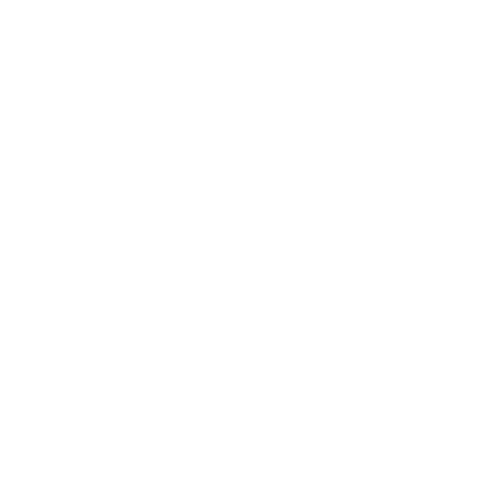La saga Bombardier continue. Après avoir reçu des milliards de subventions gouvernementales, la valeur des actions de l’entreprise a chuté de plus de 50% et l’entreprise est endettée de près de 10 milliards de dollars. Des milliers de travailleurs ont été licenciés et le gouvernement a perdu des centaines de millions de dollars. L’éléphant dans la pièce est évident pour tous. Le système capitaliste nous a laissé tomber.
Le démantèlement de Bombardier
Le lundi 17 février, la société française de transport ferroviaire Alstom a acquis la division ferroviaire de Bombardier pour un total de 10 milliards de dollars canadiens. Cette acquisition survient quatre jours seulement après que Bombardier ait jeté l’éponge après la vente finale de son projet A220 (anciennement CSeries) à Airbus. Un total de six milliards de dollars canadiens ont été investis dans le projet, dont 1,3 milliard par le gouvernement du Québec. Airbus a accepté de payer 591 millions de dollars US pour acquérir 75% du programme. Malgré l’incapacité de ce programme à décoller, le gouvernement du Québec détient toujours les 25% restants. Cela signifie que le gouvernement du Québec devra inclure une perte de 600 millions de dollars dans le budget de l’année prochaine, car son investissement de 1,3 milliard de dollars canadiens ne vaut que 700 millions de dollars aujourd’hui.
Ces ententes s’inscrivent dans le cadre des efforts continus de Bombardier pour financer sa dette. L’année dernière, Bombardier a déchargé la production de plusieurs de ses gammes de produits à des sociétés comme Mitsubishi, Longview Aviation Capital Corp, CAE Inc. et Latécoère. À l’heure actuelle, Bombardier négocie avec Textron pour vendre d’autres divisions. Ce démantèlement de Bombardier est synonyme d’incertitude croissante pour des milliers de travailleurs employés par le géant de l’aérospatiale dans le monde entier.
Le parasitisme du capitalisme en crise
La crise capitaliste a mis à nu la faiblesse du capitalisme québécois, lequel a historiquement été fortement dépendant de l’État. Incapable d’être concurrentiel sur le marché mondial, le programme CSeries de Bombardier s’est heurté à des problèmes, et les libéraux québécois se sont fait un plaisir de soutenir l’entreprise avec 1,3 milliard de dollars venus des contribuables. De plus, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui gère les régimes de retraite et d’assurances dans le secteur public, a investi deux milliards de dollars dans Bombardier Transport. C’est un total de 3,3 milliards de dollars de fonds publics donnés à la multinationale privée, sans condition. Un an plus tard, en 2017, Justin Trudeau a accordé à Bombardier un prêt supplémentaire sans intérêt de 372,5 millions de dollars. Mais si le capitalisme est si bon, pourquoi les entreprises privées ont-elles besoin des fonds publics? En réalité, le capitalisme est à bout de souffle, et il a besoin d’un respirateur artificiel pour se maintenir en vie.
On nous a dit que de donner des milliards de dollars à une entreprise privée en détresse était pour notre bien. Les faits prouvent cependant le contraire. En 2018, Bombardier employait 23 000 personnes au Canada, dont 16 000 au Québec. Ce sont des emplois qui paient 1,7 fois plus que le salaire moyen national. « Nous devons protéger ces emplois », déclare le premier ministre Legault. C’est pour cette raison que des millions et des millions de dollars des contribuables ont été donnés à Bombardier. Mais le « fleuron québécois » se soucie-t-il vraiment de sauver des emplois?
En 2015, Bombardier a lancé un plan de restructuration pour « améliorer sa rentabilité et sa compétitivité ». Seulement un an après avoir reçu 3,3 milliards de dollars du Québec, l’entreprise a annoncé qu’elle allait licencier 7500 travailleurs dans le monde entier, dont 2830 postes au Canada. En 2018, l’entreprise a promis de supprimer 5000 emplois supplémentaires, dont 3000 au Canada. La dernière série de licenciements au Canada a commencé il y a trois mois et a touché 550 travailleurs à l’usine de Thunder Bay. Il est clair que les fonds publics ne servent pas à sauver des emplois. Mais alors, où s’en va vraiment tout notre argent?
En 2015, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, a empoché un total de 8,5 millions de dollars. Un an plus tard, les cadres supérieurs ont annoncé une augmentation de 50% de leur rémunération annuelle. Cette augmentation a été suspendue à la suite d’un tollé général suscité par cette utilisation scandaleuse de fonds publics. Mais ces parasites capitalistes n’ont pas pu s’en empêcher. En 2017, la rémunération des cadres supérieurs de Bombardier a augmenté de 7% pour s’établir à 33,4 millions de dollars américains. En 2019, la rémunération annuelle de Bellemare, y compris ses généreux bonus, est passée à 10,63 millions de dollars. Cela représente une augmentation de salaire de 60% en quatre ans.
On pourrait croire que la rémunération est d’une manière ou d’une autre liée à un travail bien fait. Mais ce n’est pas le cas chez Bombardier! Bombardier a un bilan affreux de retards et d’incompétence. Il a fallu à la compagnie sept années complètes d’échéances non respectées et de menaces de poursuites judiciaires pour fournir ses 204 tramways à la Commission de transport de Toronto. Et après un retard de quatre ans, Bombardier a finalement complété une commande de 468 voitures de métro à la Société de transport de Montréal en 2018. De plus, des trains Bombardier ont été signalés comme étant défectueux à Londres, à New York et en Suisse. Et ses avions ne sont pas mieux : la tristement célèbre gamme CSeries (aujourd’hui A220) a connu plusieurs problèmes de moteur depuis 2014. Bombardier est comme un avion dont le moteur est défaillant. C’est seulement grâce aux milliards de dollars des contribuables qui continuent à l’alimenter qu’il ne s’est pas encore écrasé.
Nous avons ici une entreprise qui est en difficulté sur le marché mondial et qui ne peut pas respecter les délais de production. La saga Bombardier représente un microcosme de tout le système capitalisme actuel, dans toute sa splendeur. Sous le capitalisme, des entreprises inefficaces comme Bombardier sont maintenues à flot avec des ressources publiques. Elles agissent comme des parasites sur la société, drainant nos ressources uniquement pour protéger leurs profits.
Le Manifeste du Parti communiste explique que l’État sous le capitalisme n’est « qu’un comité pour gérer les affaires communes de toute la bourgeoisie ». Les gouvernements fédéral et québécois ont joué ce rôle à merveille en ce qui concerne Bombardier. Alors que des entreprises comme Alstom ont fait irruption pour engloutir des parties de Bombardier, rien ne garantit que ces milliers d’emplois seront protégés sous le capitalisme.
Dans une lettre ouverte publiée le 7 février dernier, David Chartrand, vice-président de la FTQ (à qui est affiliée une partie des machinistes de Bombardier), a déclaré que souhaiter la fermeture de Bombardier équivaut à souhaiter l’appauvrissement collectif des Québécois. Il est vrai que la fermeture du géant de l’aérospatiale mettrait en péril le gagne-pain de milliers de travailleurs et travailleuses au Québec et ailleurs au Canada. Mais nous n’avons pas à choisir entre renflouer les coffres des entreprises et fermer les usines.
Pour vraiment protéger ces emplois de qualité, le mouvement syndical doit lutter pour nationaliser Bombardier sous le contrôle démocratique des travailleurs. En faisant de Bombardier une propriété collective, la classe ouvrière pourrait gérer démocratiquement la production, sans le chaos du marché mondial et de la recherche du profit. Les travailleurs de Bombardier savent mieux que quiconque comment gérer la production, et leurs connaissances et compétences, combinées à un plan socialiste visant à étendre massivement le système de transport public dans toutes les grandes villes, pourraient contribuer à sauver de bons emplois, tout en combattant la crise environnementale. Ce potentiel ne peut être réalisé que si nous rompons avec la logique de profit qui sous-tend la production capitaliste, et si nous luttons pour une économie qui place les besoins humains au-dessus des appétits du secteur privé.