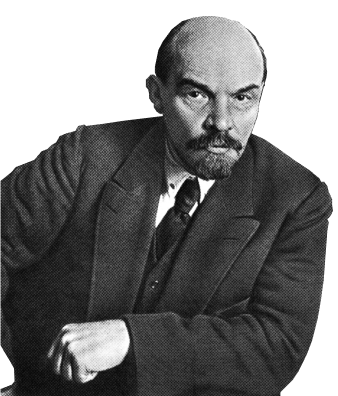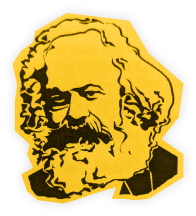Un jour, tout semble calme et la clique au pouvoir dans un pays donné paraît solidement installée. Le lendemain, les masses révolutionnaires se tiennent devant un parlement en flammes. La police a disparu, les députés ont fui, et le premier ministre aussi. Les photos et vidéos récentes en provenance du Népal étaient saisissantes. Leur ressemblance avec les scènes déjà vues au Sri Lanka, au Bangladesh, au Kenya et en Indonésie était frappante.
Quelle est la signification de ces événements? À gauche, certaines personnes, impressionnées par ces images, se laissent emporter par la vague sans prendre le temps de se demander où elle mène. Elles se comportent comme des cheerleaders des masses, ce qui est la dernière chose dont les masses ont besoin en pleine révolution.
D’autres gens regardent ces événements l’air aigri. Ils observent le Népal, le Sri Lanka, ou tout autre exemple similaire, et les comparent aux schémas qu’ils se sont forgés de ce à quoi une révolution devrait ressembler.
Ils ne trouvent pas de soviets. Ils ne trouvent pas de conseils ouvriers. Ils voient plutôt des masses organisées – dans la mesure où elles le sont – autour d’un leadership accidentel, ou même autour de simples mots-clics sur les réseaux sociaux. Ils ne trouvent pas de drapeaux rouges, mais des drapeaux sri lankais, kényans, bangladais et népalais.
Ils considèrent les rares revendications de ces mouvements comme vagues et limitées, surtout comparées au programme complet d’une révolution socialiste. Et ils soulignent le fait indiscutable que, jusqu’à présent, ces révolutions n’ont pratiquement apporté aucun changement fondamental. Ils déclarent avec mépris que ce ne sont pas du tout des révolutions, puis retournent dormir en demandant qu’on les réveille quand la « vraie » révolution arrivera.
En tant que communistes authentiques, nous ne pouvons ni nous laisser impressionner par les apparences, ni exiger des révolutions qu’elles collent à des schémas préconçus. Nous devons saisir l’essence des événements concrets et en tirer des leçons concrètes.
Quelle doit donc être notre attitude face à ces événements en cours?
Ces révolutions, du Sri Lanka au Népal, ont chacune leurs particularités. Mais on voit déjà émerger des tendances claires et indéniables. Ensemble, elles nous en disent long sur le caractère de l’époque dans laquelle nous sommes entrés.
La puissance des masses
La première chose à dire, c’est que nous n’aurions pas pu en demander davantage en termes d’effort ou d’héroïsme de la part des masses révolutionnaires. Elles ont démontré l’immense puissance latente qu’elles possèdent.
Il y a trois ans, lorsque le peuple s’est rué vers le palais présidentiel au Sri Lanka – le premier domino à tomber – les policiers ont été balayés comme des moustiques. La famille Rajapaksa a fui. Aucune autre force dans la société ne pouvait rivaliser avec cette puissance.
Le régime s’est retrouvé suspendu dans le vide, impuissant. La révolution aurait pu l’écraser sur-le-champ. En réalité, le pouvoir était déjà entre les mains des masses dans la rue. Il ne restait plus qu’à déclarer l’ancien régime renversé. Mais les masses n’étaient pas conscientes de détenir ce pouvoir, et il n’existait aucun parti avec assez d’autorité pour le saisir en leur nom.
Ainsi, le soir même de cette victoire éclatante, il ne restait plus rien d’autre à faire aux masses révolutionnaires que de quitter le palais présidentiel et de rentrer à la maison. Ensuite, l’ancien parlement honni, dominé par le parti majoritaire des Rajapaksa, a choisi le remplaçant pour la présidence.
Le 5 août 2024, le régime au Bangladesh s’est lui aussi retrouvé suspendu dans le vide. La police, qui avait semé la terreur au cours des semaines précédentes, a déclaré une « grève ». En fait, elle avait fui, terrifiée à l’idée des représailles des masses. Sur les 600 postes de police du pays, 450 avaient été réduits en ruines fumantes. La première ministre honnie, Sheikh Hasina, a été escortée par les hauts gradés de l’armée jusque dans un hélicoptère qui l’a emmenée hors du pays.
Les masses révolutionnaires détenaient alors le pouvoir et auraient pu organiser leur propre gouvernement révolutionnaire. Mais encore une fois, elles n’étaient pas conscientes de ce pouvoir qu’elles détenaient. L’ancien régime était vaincu. Les vieux généraux et juges auraient pu et auraient dû être balayés. Au lieu de cela, les leaders étudiants sont allés négocier avec ces généraux défaits. Ils ont accepté un gouvernement intérimaire dirigé par un ex-banquier, au sein duquel ils occuperaient des postes symboliques.
Au Kenya, malgré tous les sacrifices et le sang versé, encore moins de choses ont été accomplies. Ruto reste solidement accroché au pouvoir.
Le grand mystère dans tous ces cas réside dans le contraste entre l’écrasante puissance que les masses ont démontrée et le peu de changements concrets qui en ont découlé.
Ceci s’explique par le seul facteur absent, sur lequel nous reviendrons continuellement : l’absence d’un leadership révolutionnaire. Sans direction, la confusion règne quant au programme et au but de la révolution. Toutes ces révolutions se sont arrêtées à mi-chemin.
Mais à ceux qui prétendent que ce n’étaient pas de vraies révolutions, nous répondons : aucune autre forme de révolution n’était possible dans ces circonstances. Lénine a répliqué à cette objection de façon définitive lorsqu’il répondait à ceux qui niaient la signification révolutionnaire de l’insurrection de Pâques de 1916 en Irlande, eux qui la qualifiaient de simple « putsch » :
« Croire que la révolution sociale soit concevable sans insurrections des petites nations dans les colonies et en Europe, sans explosions révolutionnaires d’une partie de la petite bourgeoisie avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politiquement inconscientes contre le joug seigneurial, clérical, monarchique, national, etc., c’est répudier la révolution sociale. C’est s’imaginer qu’une armée prendra position en un lieu donné et dira “Nous sommes pour le socialisme”, et qu’une autre, en un autre lieu, dira “Nous sommes pour l’impérialisme”, et que ce sera alors la révolution sociale! C’est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu’on pouvait qualifier injurieusement de “putsch” l’insurrection irlandaise. Quiconque attend une révolution sociale “pure” ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n’est qu’un révolutionnaire en paroles qui ne comprend rien à ce qu’est une véritable révolution. » (Lénine, Bilan d’une discussion sur le droit des nations à disposer d’elles-mêmes)
Le problème du leadership
Il manque effectivement un leadership clair à ces mouvements. Mais le fait est que les conditions des masses sont trop désespérées pour attendre l’arrivée de ce facteur manquant. La jeunesse, surtout, est la moins disposée à patienter jusqu’à ce que les conditions idéales soient réunies.
Une autre caractéristique marquante de tous ces bouleversements révolutionnaires, c’est l’irruption d’une toute nouvelle génération sur la scène. Privée d’un avenir, ayant le moins à perdre et le plus à gagner, la jeunesse, pleine d’énergie et non écrasée par le poids des défaites passées, s’est retrouvée en première ligne partout.
Au Népal et au Kenya, ces mouvements sont appelés la « révolution Gen Z ». En Serbie et au Bangladesh, d’immenses mouvements étudiants, tel un paratonnerre, ont canalisé la colère de millions de travailleurs et de pauvres.
Même si les formes varient d’un pays à l’autre, la jeunesse a en général fourni ce qui tenait lieu de leadership. Apporte-t-elle de la confusion? Bien sûr. Mais qui en est responsable? Nous répondons sans hésiter : c’est la faute des dirigeants des organisations ouvrières, dont le rôle devrait être de diriger.
Le fait honteux est que leur absence lâche a servi de contrepoint ignoble au courage de cette jeunesse qui a combattu en première ligne.
Tout comme les généraux au Kenya et au Bangladesh ont maintenu les soldats dans leurs casernes pour éviter qu’ils soient contaminés par la révolution, les lourds bataillons de la classe ouvrière ont été maintenus dans leurs propres « casernes » par les dirigeants ouvriers.
C’est tout simplement criminel. Seule la classe ouvrière détient le pouvoir d’attaquer à sa racine le capitalisme, qui représente la véritable source de toute la misère et de toutes les souffrances des masses.
Dans bien des cas, la jeunesse a tenté de se tourner vers les travailleurs. Les étudiants de Serbie ont avec raison interpellé les syndicats pour qu’ils organisent une grève générale contre le régime de Vučić, et ont appelé à la formation de zborovi (assemblées de masse) dans les lieux de travail, et c’est tout à leur honneur. Mais les bureaucrates bornés des bureaux syndicaux ont résisté à tous ces appels, qu’ils percevaient comme une menace à leurs petits fiefs.
Au Kenya, le lamentable secrétaire général de la centrale syndicale COTU-K est même allé jusqu’à défendre la loi de finances régressive de Ruto en 2024, celle-là même qui a déclenché tout le mouvement!
Et au point culminant de l’aragalaya (la « lutte ») au Sri Lanka en 2022, l’idée d’un hartal (grève générale révolutionnaire) circulait largement. Mais les syndicats se sont refusés à lancer autre chose qu’une grève d’un jour.
Contre la corruption
Dans tous ces mouvements, nous avons vu comment les masses ont pris pour cible les symboles les plus évidents et les plus forts qui suscitent leur colère.
Les cliques pourries qui dominent chaque pays, aussi haïes pour leur brutalité que pour leur corruption, ont attiré sur elles toute la fureur des masses : la clique Rajapaksa au Sri Lanka; la clique Hasina au Bangladesh; la clique Ruto au Kenya; les dirigeants et leurs « nepo kids » (les « fils et filles de ») au Népal; les politiciens qui s’octroient des hausses de salaire faramineuses en Indonésie; Vučić et ses voyous en Serbie.
Et surtout, les masses au Sri Lanka, au Kenya, au Bangladesh, au Népal, en Indonésie et ailleurs se sont soulevées d’abord contre la corruption.
Beaucoup de sceptiques soulèvent ce fait d’un air moqueur, affirmant que c’est bien la preuve qu’il ne s’agit pas de révolutions. Une vraie révolution, disent-ils, viserait le capitalisme, pas la corruption.
Mais la corruption n’est que le symptôme le plus extrême et le plus criant de toute la pourriture du système capitaliste lui-même. Les masses sont animées d’un profond sentiment d’injustice, de haine et d’indignation quand elles pensent aux richesses absolument colossales qui les entourent. Mais elles voient bien que ces richesses sont détournées par une élite corrompue.
Les commentateurs occidentaux désignent la corruption comme une caractéristique malheureuse du soi-disant « tiers-monde » et comme la cause du sous-développement. Bien sûr, ils le font pour camoufler les traces de l’impérialisme, qui est la cause principale de la pauvreté et du sous-développement.
Or, une corruption semblable sévit dans tous les pays capitalistes, en particulier en Europe. Songeons à la ressemblance entre l’effondrement mortel d’un auvent à Novi Sad, en Serbie, et la catastrophe ferroviaire de Tempi, en Grèce, qui ont tous deux provoqué d’énormes manifestations de masse. Dans les deux cas, ce sont des politiciens corrompus qui sont responsables. Pendant qu’ils comptent l’argent amassé grâce aux pots-de-vin et aux magouilles, les pauvres comptent leurs morts causés par les désastres engendrés par cette corruption.
Pendant ce temps, un conducteur de taxi pousse-pousse au Sri Lanka ou au Bangladesh n’a qu’à comparer sa faim lancinante aux projets extravagants futiles comme la Lotus Tower à Colombo ou le pont Padma sur le Gange pour mesurer le gouffre qui le sépare de ses dirigeants. Alors que Jakarta est un enfer sur terre pour les pauvres, le gouvernement indonésien est occupé à construire une nouvelle capitale étincelante, loin de la misère et de la crasse de la capitale actuelle.
Quand les masses se sont soulevées contre le régime au Sri Lanka, en Indonésie, au Bangladesh, au Népal, ce sont ces hypocrites choyés, ces soi-disant « leaders de la nation », qu’elles ont frappés. Elles ont instinctivement visé le sommet de ces cliques pourries, et nous ont donné ces images de parlements pris d’assaut, de palais présidentiels saccagés, de bureaux de partis et de résidences de députés incendiés.
Les masses ont eu le bon instinct en s’attaquant à ces gangsters corrompus qui, grâce à leurs fonctions, s’enrichissent sans fin. Mais, au bout du compte, même quand ces personnes sont chassées du pouvoir, d’autres attendent dans les coulisses pour prendre leur place. Ce qu’il faut en retenir, c’est que pour en finir avec la corruption, il faut en finir avec la domination du capital. Et cela implique d’abolir la propriété privée et d’écraser les corps armés de l’État capitaliste, qui constituent la véritable source du pouvoir de la classe dirigeante.
Une haine envers tous les partis
Dans presque tous ces mouvements, un sentiment domine : ce n’est pas seulement la clique dirigeante actuelle qui est pourrie, mais l’ensemble des politiciens et des partis qui sont considérés comme aussi mauvais les uns que les autres. La prétendue « opposition » s’est révélée, dans la plupart des cas, tout aussi corrompue.
Et ce n’est pas seulement pour la corruption qu’elle est honnie. Le simple fait de participer au même jeu parlementaire détesté, et d’employer le même langage rempli de mensonges, souille l’opposition tout autant que les partis au pouvoir.
Ainsi, au Sri Lanka, aux côtés du slogan « Gota va-t’en » visant le président corrompu Gotabaya Rajapaksa, les masses ont scandé « les 225, allez-vous-en » – c’est-à-dire les 225 députés qui composent le parlement.
Au Kenya, la jeunesse appelle les députés « MPigs » (des « porcs-lementaires »). Et elle a bien raison! Tout en légiférant pour appauvrir davantage les pauvres, ces « MPigs » – tous sans exception – se gavent dans l’auge des dépenses et des privilèges parlementaires. La jeunesse kényane ne veut rien savoir de Ruto, mais elle ne veut pas non plus avoir affaire à des leaders d’opposition comme Odinga, qu’on a vite vu trembler de peur derrière Ruto face à la jeunesse révolutionnaire.
Leur slogan, « sans tribu, sans chef, sans parti », exprimait un rejet instinctif très sain de toutes ces bandes tribales capitalistes qu’on appelle « partis politiques » au Kenya.
Mais si tous les partis existants sont des outils au service de telle ou telle faction corrompue de la classe dirigeante, cela signifie-t-il que les travailleurs et la jeunesse peuvent se passer d’un parti, tout court? Pas du tout. La situation exige au contraire un parti et un leadership qui leur est propre, représentant véritablement leurs intérêts.
La gauche n’est pas meilleure
Ce rejet de tous les partis politiques reflète aussi le fait que, dans la majorité des cas, les partis dits « de gauche » ne valent pas mieux que ceux de droite!
Dans certains cas, la « gauche » est devenue aussi corrompue que les partis de droite. Bien souvent, ces arrivistes envieux finissent même par être pires, au point d’inspirer un dégoût insupportable pour le mot « gauche » lui-même.
Ce n’est pas seulement le fruit de défauts ou de faiblesses morales de la part de la gauche. Cette pourriture prend racine dans de faux principes théoriques. La responsabilité particulière de ce triste état de choses incombe au stalinisme et à sa nocive « théorie des étapes ». Celle-ci a conduit directement de nombreux partis de gauche à s’allier aux éléments les plus pourris de la classe dirigeante.
Selon cette théorie, les tâches les plus urgentes dans les pays sous-développés ne sont pas socialistes, mais démocratiques-bourgeoises. Il y a un élément de vérité ici.
Le désir le plus pressant et le plus clair des masses dans des pays capitalistes arriérés comme le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka et l’Indonésie est de briser la domination corrompue et arbitraire des régimes actuels. Avant tout, les masses vivant sous ces régimes brutaux veulent respirer librement. Elles veulent des droits démocratiques.
En elles-mêmes, il n’y a rien de fondamentalement socialiste dans ces tâches. Ce sont ce que les marxistes appelleraient des tâches « démocratiques-bourgeoises ».
Mais à partir de ce constat que la révolution est confrontée à de telles tâches démocratiques-bourgeoises, la théorie stalinienne des « étapes » conclut qu’il faut chercher une aile « progressiste » de la bourgeoisie pour diriger la révolution. Ce n’est qu’après des années de développement capitaliste – supposément inaugurées par cette étape bourgeoise de la révolution – que le pays deviendrait mûr pour le socialisme.
Il n’y a qu’un seul petit bémol. Il n’existe aujourd’hui aucune aile « progressiste » de la bourgeoisie dans aucun pays arriéré. C’est une classe entièrement parasitaire, complètement dépendante de l’impérialisme. Elle est terrifiée par les masses révolutionnaires, et surtout par la seule classe réellement révolutionnaire de la société : la classe ouvrière. Toutes ses politiques, ses actions et ses discours le démontrent.
Dans leur recherche du mirage de la bourgeoisie « progressiste », les staliniens se sont collés aux talons d’une clique pourrie après l’autre.
Le Parti communiste du Bangladesh, par exemple, a soutenu pendant des décennies la Ligue Awami de Hasina et de son père, Mujib. Ils présentaient la Ligue Awami comme les défenseurs « progressistes » de la libération nationale du Bangladesh et justifiaient leur appui continu en arguant que la Ligue « laïque » représentait un moindre mal face aux fondamentalistes religieux du Jamaat-e-Islami.
Résultat : ils partagent aujourd’hui le discrédit de Hasina, tandis que les réactionnaires du Jamaat-e-Islami peuvent se présenter comme les martyrs du régime de la Ligue Awami de Hasina.
Faute de parti révolutionnaire capable de lier la question de la corruption à celle du capitalisme, les islamistes ont pris les devants et ont commencé à parler de « lutter contre la corruption » eux-mêmes. « Oui, nous sommes aussi contre les politiciens corrompus », disent-ils. « Nous avons besoin d’une politique plus propre, de nouveaux visages à la place des anciens. » Ces réactionnaires détournent la colère contre la corruption loin du capitalisme et vers d’autres causes supposées, comme le manque de morale ou de piété des laïques.
Mais l’échec le plus accablant de la théorie stalinienne « des étapes » est sans doute le cas du Népal, où les maoïstes dominent la scène politique du pays.
Après une insurrection qui a duré dix ans, les maoïstes ont été propulsés au pouvoir grâce à la vague révolutionnaire de 2006. Qu’ont-ils fait? Ils ont aussitôt signé un accord en 12 points en commun avec des partis ouvertement bourgeois comme le Congrès népalais, et le pays est depuis gouverné par des coalitions entre ces soi-disant « communistes » et ces éléments bourgeois.
Leur explication était que toutes les forces « progressistes » et « anti-féodales » devaient s’unir pour abolir la monarchie et bâtir une république. Cela devait permettre le développement du capitalisme népalais qui, à un certain stade, poserait les bases pour une révolution socialiste au Népal.
Mais entre 2008 et 2025, aucun progrès réel n’a été enregistré. Le Népal est passé du 140e au 145e rang sur 193 pays selon l’Indice de développement humain. Chaque année, des milliers de jeunes népalais fuient la pauvreté pour aller travailler à l’étranger, au point qu’un tiers du PIB du pays provient des transferts de fonds.
Après avoir administré l’État au nom de la bourgeoisie pendant une décennie et demie, les politiciens maoïstes sont eux-mêmes devenus la cible de la haine des masses. Ils sont tout aussi empêtrés dans la corruption que les partis ouvertement bourgeois.
Parmi les « nepo kids », dont la richesse ostentatoire a provoqué les récents événements, qui retrouve-t-on? Des jeunes comme Smita Dahal, exhibant des sacs à main valant plusieurs fois le salaire mensuel moyen d’un travailleur népalais, et dont le grand-père n’est nul autre que Prachanda, l’ancien dirigeant de la guérilla maoïste.
Des révolutions de couleur?
Il existe une opinion, populaire parmi les défenseurs des vertus du nouveau monde « multipolaire », selon laquelle ce à quoi nous assistons est tout le contraire d’une révolution. Ils affirment qu’il s’agit de contre-révolutions ou de révolutions « de couleur », c’est-à-dire de complots obscurs ourdis par les agences de renseignement occidentales pour manipuler les masses.
On a souvent dit la même chose du Printemps arabe, qui présentait de nombreuses similitudes avec la vague actuelle de révolutions. On peut comprendre pourquoi certaines personnes pensent à tort qu’il s’agissait d’une conspiration. La classe ouvrière égyptienne n’a pas réussi à prendre le pouvoir. Résultat? Al-Sissi a remplacé Moubarak, et la situation est aujourd’hui cent fois plus difficile en Égypte qu’elle ne l’était en 2010. En Libye et en Syrie, l’impérialisme a réussi à plonger ces pays dans une guerre civile barbare.
Le fait que la vague actuelle de révolutions se concentre en Asie du Sud et que certains des régimes ébranlés soient proches de la Chine renforce l’idée qu’il s’agit d’un changement de régime orchestré par l’Occident.
Il y a une certaine ironie dans cette idée que nous assistons actuellement à une vague de révolutions de couleur.
Les défenseurs d’un « monde multipolaire » affirment que la gauche doit lutter contre l’impérialisme en soutenant les régimes bourgeois « progressistes » et « anti-impérialistes » du « Sud global ». Mais ils sont aveugles au fait que si la gauche est aujourd’hui si discréditée, laissant un vide dans lequel les réactionnaires peuvent s’insérer, c’est précisément parce qu’elle a défendu pendant des années la même chimère d’une bourgeoisie nationale « progressiste » et « anti-impérialiste »!
L’idée selon laquelle il s’agit de « révolutions de couleur » est fausse. Les complots n’expliquent pas ce que nous voyons. Mais c’est une idée fausse qui contient un élément de vérité. Sans leadership révolutionnaire, la contre-révolution peut prendre le dessus, les impérialistes peuvent trouver des ouvertures pour intervenir et les choses peuvent dégénérer dans une direction très réactionnaire.
Nous devons dire sans détour que le bilan de ces révolutions le confirme. C’est une leçon importante à assimiler.
En Syrie, l’incapacité de la révolution à formuler un programme prolétarien a permis aux impérialistes de détourner le mouvement et de le transformer en une insurrection islamiste. De même, le soulèvement de la jeunesse iranienne en 2018, faute d’avoir développé une approche de classe claire, a dérivé vers l’orbite de l’opposition libérale soutenue par l’Occident.
Qu’en est-il des exemples plus récents? Au Kenya, Ruto est toujours au pouvoir. C’est un fait que les jeunes n’ont pas réussi à le renverser par de simples journées d’action. Au Bangladesh et au Sri Lanka, l’ancien régime a été renversé. Et pourtant, dans ces trois pays, les gouvernements mènent une politique d’austérité et s’attaquent à la classe ouvrière et aux pauvres à la demande du FMI. Tous sont contraints de mener cette politique, car c’est la seule politique possible sous le capitalisme.
Malgré l’enthousiasme débordant suscité par la « reprise » économique au Sri Lanka, jusqu’à l’année dernière, le taux de pauvreté restait deux fois plus élevé qu’au début de l’année 2022. Les jeunes cherchent à émigrer s’ils le peuvent, ou se retrouvent piégés dans des emplois où ils travaillent sans compter leurs heures pour survivre. Au Bangladesh, quelque 2,1 millions d’emplois ont été perdus depuis le mouvement de juillet 2024.
Les conditions continuent de se détériorer. Le fait est que la cause profonde de la souffrance et du mécontentement des masses découle de la crise du capitalisme, et ces révolutions n’ont pas frappé à la racine du capitalisme.
La corruption n’a pas non plus été éradiquée. Au Bangladesh, les leaders étudiants ont largement perdu leur autorité. La cerise sur le gâteau, c’est ce qui est arrivé au système de quotas qui a déclenché la révolution. Les étudiants se sont mobilisés l’année dernière pour mettre fin à la discrimination, et plus précisément pour mettre fin aux quotas d’emplois bien rémunérés dans le secteur public réservés aux membres des familles des vétérans de la guerre d’indépendance de 1971. Il s’agissait d’un système qui, de facto, fournissait des emplois aux laquais de Hasina et du régime de la Ligue Awami.
Ce système de quotas a effectivement été supprimé… et remplacé par un système de quotas où les emplois sont attribués aux membres des familles des vétérans du soulèvement de juillet 2024!
Tout ce qui est possible sous le capitalisme, c’est une nouvelle répartition du butin. Le pillage, quant à lui, est sans fin.
Processus inachevés
Les révolutions ne sont pas une pièce en un acte. L’histoire n’a pas fini d’être écrite. Au Sri Lanka, au Népal et au Bangladesh, l’ancien régime détesté a été renversé. Les masses ont remporté des victoires initiales qui se sont avérées éblouissantes. Mais à y regarder de plus près, il s’avère que la victoire était plus apparente que réelle. La tête du régime est partie, mais le vieil État et la vieille classe dirigeante détiennent toujours le pouvoir.
Les événements dont il est question ressemblent à ce qui s’est passé en Russie en février 1917.
Les travailleurs russes ont fait irruption sur la scène politique avec une grève générale révolutionnaire. En quelques jours, le tsar a été contraint d’abdiquer. Un gouvernement provisoire a été mis en place. Mais lorsque l’enthousiasme est retombé, il est devenu clair que les anciens généraux et bureaucrates monarchistes étaient toujours aux commandes. Les capitalistes possédaient toujours les usines, les propriétaires fonciers détenaient encore toutes les terres. C’était le tsarisme, mais sans le tsar.
La victoire ne serait complète qu’une fois l’ancien État renversé et une fois les travailleurs eux-mêmes au pouvoir. C’est ce qui s’est produit lors de la révolution d’octobre 1917. Et elle n’a été possible que grâce à la présence du Parti bolchevique, qui a clarifié les objectifs de la révolution et rallié la classe ouvrière et les autres masses opprimées de Russie à sa bannière.
Sans le parti, l’ancienne classe dirigeante aurait très bien pu plonger la Russie dans la barbarie. Une guerre civile accompagnée de pogroms aurait plané sur les masses. Selon toute vraisemblance, la Russie aurait été partagée entre les puissances impérialistes et des millions de personnes auraient péri.
Autrement dit, la Russie aurait subi un sort similaire à celui que connaît aujourd’hui le Soudan. Là-bas, les masses révolutionnaires ont eu une occasion rêvée de prendre le pouvoir en 2019. Le leadership a laissé passer cette occasion, et aujourd’hui, le pays est déchiré par une guerre civile barbare entre deux gangs armés réactionnaires et les puissances impérialistes qui les soutiennent.
Bien sûr, une issue réactionnaire aussi dévastatrice que celle que nous voyons actuellement au Soudan n’est en aucun cas inévitable. La force de la classe ouvrière et toute une série d’autres facteurs entrent en jeu pour déterminer l’issue. Mais il s’agit néanmoins d’un avertissement brutal.
Qui sera le prochain?
Les événements révolutionnaires au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal, en Indonésie, au Kenya et ailleurs continueront leur déroulement. Il y aura des avancées et des reculs, et il n’y a pas de doute que nous aurons même droit à de nouveaux soulèvements insurrectionnels.
Si l’histoire du bolchevisme de 1903 à 1917 nous enseigne une chose, c’est qu’un parti doit être construit avant la révolution s’il veut jouer un rôle décisif. Nous hésitons à dire qu’un parti révolutionnaire ne peut pas être construit au milieu d’une révolution – mais ce n’est certainement pas chose facile.
Nous nous adressons donc aux travailleurs et aux jeunes révolutionnaires les plus avancés de partout dans le monde qui n’ont pas encore été secoués par la révolution. La construction du parti révolutionnaire doit être entreprise de toute urgence! Tous les exemples que nous avons cités le démontrent.
Il faut du temps pour former les cadres d’un futur parti révolutionnaire de masse. Or, nous n’avons pas tout le temps du monde devant nous. Les conditions qui ont engendré les révolutions dans tous les pays mentionnés précédemment mûrissent rapidement partout.
Il est remarquable à quel point ces conditions sont similaires d’un pays à l’autre.
À première vue, ces pays n’étaient même pas les plus affectés par la crise. Loin de là. Ils connaissaient une croissance économique qui rend jaloux les économistes des pays capitalistes avancés.
Entre 2010 et 2024, à l’exception de l’année 2020 marquée par la pandémie, le Népal a connu une croissance annuelle moyenne de 4,7 %, le Kenya de 5,2 % et l’Indonésie de 5,23 %. Le Sri Lanka est entré en crise plus tôt, mais entre 2010 et 2018, il a également connu une croissance moyenne de 6,43 % par an.
Mais sous la surface, que trouve-t-on? Une croissance extrêmement inégale et sans création d’emploi, une pauvreté persistante et une montagne de dettes usuraires impossibles à rembourser contractées auprès des impérialistes. Le chômage élevé chez les jeunes et l’absence de tout avenir est un thème récurrent qui menace la classe dirigeante.
Au Sri Lanka, le taux de chômage des jeunes était de 25 % en 2021, soit quatre à cinq fois le taux moyen. Sur les 44 millions de jeunes que compte l’Indonésie, sept millions sont sans emploi. Au Bangladesh, moins d’un jeune de 25 à 29 ans sur cinq a un emploi stable avec un contrat de plus d’un an. Avant la pandémie, 39 % des diplômés du pays étaient au chômage.
« Nous n’avons ni emploi ni avenir », affirmait un jeune Kenyan, « nous avons donc tout le temps du monde pour vous renverser, et rien à perdre en vous affrontant. »
S’agit-il là de caractéristiques propres à ces pays? Non. Elles sont remarquablement similaires à ce que nous voyons dans de très nombreux pays.
En 2023, 21 pays où vivent 700 millions de personnes étaient en faillite ou au bord de la faillite. Trois milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus pour payer les intérêts sur leur dette que pour les soins de santé ou l’éducation.
Même pendant les « belles années », les masses avaient déjà du mal à garder la tête hors de l’eau. C’est particulièrement vrai pour les pays pauvres et les soi-disant pays à revenu intermédiaire, qui ne disposaient pas des réserves nécessaires pour faire face aux ravages de la crise déclenchée par la pandémie de COVID-19.
Lorsque la révolution a secoué le Sri Lanka en 2022, nous avions prédit que des événements similaires se produiraient pays après pays, car ils partagent les mêmes caractéristiques fondamentales. C’est ce qui s’est produit, et nous prédisons avec certitude que la longue liste de pays touchés par la révolution va s’allonger encore. Les classes dirigeantes de l’Inde et du Pakistan – et leurs nombreux « nepo babies »! – doivent trembler dans leurs chaussures en voyant ce qui se passe ailleurs.
Cette vague révolutionnaire a commencé dans les pays les plus pauvres et les moins développés, mais elle ne restera pas confinée à ces derniers. Comme l’expliquait Trotsky, « la goutte commence par le petit doigt ou le gros orteil, mais une fois qu’elle a commencé, elle progresse jusqu’à atteindre le cœur ».
Les flammes de la révolution atteignent déjà les côtes de l’Europe en Serbie, et le mouvement « Bloquons tout » en France montre que la révolution va effectivement se frayer un chemin jusqu’au cœur du continent. Le monde est tout feu tout flamme, et les explosions révolutionnaires sont à l’ordre du jour. En tant que révolutionnaires, nous devons assimiler ce fait, et en tirer les conclusions qui s’imposent – avant tout, la responsabilité de bâtir de toute urgence un parti révolutionnaire.