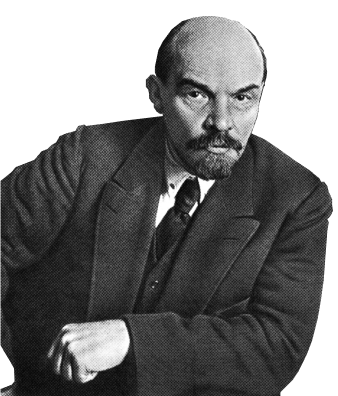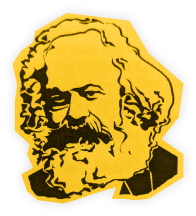La guerre commerciale mondiale lancée par Trump s’est déjà transformée en une confrontation entre les deux acteurs dominants de l’économie mondiale, les États-Unis et la Chine. La question est posée : qui a le meilleur jeu? Qui cédera le premier? Cette question déterminera le sort de l’économie mondiale.
Trump pense qu’en passant immédiatement à l’offensive de manière extrêmement agressive, il réussira à intimider et déstabiliser la Chine pour l’amener à conclure un accord. Il considère les tarifs comme une tactique de négociation, et s’imagine que plus il est téméraire, plus la Chine sera forcée de lui concéder un accord à son avantage. Mais il n’a pas compris les forces de la Chine, ni les faiblesses des États-Unis.
Le jeudi 3 avril, le lendemain du jour où son administration a lancé sa guerre commerciale, le soi-disant « Jour de la Libération », le vice-président JD Vance a cru bon de déclarer à Fox News : « Nous empruntons de l’argent aux paysans chinois pour acheter les choses que ces paysans chinois fabriquent. » Il ne fait aucun doute qu’il s’adressait à ses soutiens en Amérique, mais Xi Jinping a également des soutiens en Chine, et ceux-ci ont un rôle à jouer dans la manière dont la Chine réagit aux menaces américaines.
Naturellement, le gouvernement chinois a saisi cette occasion, et s’est assuré diffuser les commentaires de Vance sur les médias sociaux chinois. Les Chinois sont parfaitement conscients du « siècle d’humiliation », comme ils l’appellent à juste titre, qu’ils ont subi de la part d’impérialistes occidentaux arrogants, et ne supportent pas d’être traités de paysans. Sans trop d’efforts, le gouvernement chinois peut et va rallier la population autour du thème « Qui sont ces Américains arrogants et paresseux pour nous traiter de paysans? Nous allons leur montrer qui sont les vrais paysans! »
L’administration Trump a non seulement déclenché les hostilités, ce qui permet au régime chinois d’imputer les difficultés économiques aux impérialistes américains, mais a insulté les Chinois par-dessus le marché. Ce faisant, elle a relevé le « seuil de douleur » de la Chine dans cette guerre commerciale dramatique.
Toutefois, l’économie chinoise va souffrir considérablement. Elle risque d’être complètement coupée de son plus grand marché. Elle a donc de fortes raisons de négocier avec Trump, de faire des concessions et de parvenir à un accord. En revanche, Xi Jinping risque de perdre beaucoup de crédit s’il est perçu comme agissant de la sorte.
Qui gagnera?
Yanis Varoufakis, le « marxiste erratique », semble penser que l’Amérique a un grand avantage dans cette guerre commerciale. En ce qui concerne l’Europe, il a déclaré le 8 avril : « Lorsque vous enregistrez un excédent annuel de 240 milliards de dollars avec les États-Unis, vous ne pouvez pas gagner une guerre commerciale. Point final. » L’excédent commercial de la Chine s’est élevé à 295 milliards de dollars l’année dernière, selon Reuters. Selon la logique de Varoufakis, elle est donc en position de faiblesse : en menaçant de l’exclure de son énorme marché, les États-Unis peuvent faire plier la Chine.
Est-il vrai que le pays ayant un déficit commercial important, c’est-à-dire le pays qui fournit un grand marché à l’autre, est dans une position de négociation plus forte? La vérité est beaucoup plus complexe que ne le suggère Varoufakis, du moins en ce qui concerne la Chine. Surtout, un pays avec un énorme déficit commercial n’est guère en position de force en général, même si son marché est décisif pour le pays exportateur.
Une relation commerciale n’est rien de moins que cela : une relation. Une relation commerciale telle que celle entre les États-Unis et la Chine, c’est-à-dire la relation au cœur de l’économie mondiale, est une relation symbiotique : chacun dépend de l’autre.
La Chine se prépare à cette situation depuis un certain temps, en développant des marchés et des relations avec d’autres pays, et en développant davantage de technologies domestiques afin d’accroître son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Il n’existe cependant pas de véritable solution de rechange au marché américain pour la Chine : la Chine produit trop de biens pour ce marché pour que le reste du marché mondial puisse les absorber.
Pour les États-Unis, il n’y a pas de solution de rechange aux produits chinois : ils sont trop bon marché et d’une qualité trop élevée. Les retirer de l’économie américaine, comme le propose Trump, causerait des dommages économiques inacceptables bien avant que l’industrie manufacturière américaine ne connaisse une renaissance, si même elle renaît.
La logique des tarifs est que les États-Unis peuvent forcer la Chine à céder, grâce à la position dominante des États-Unis en tant que plus grand marché du monde. Mais si les États-Unis sont le plus grand marché de la Chine, cela signifie que le marché américain est dépendant des produits chinois. Que se passera-t-il pour le marché américain s’ils sont soudainement retirés?
De très nombreux produits de consommation dont les Américains dépendent pour toutes sortes de choses, des plus frivoles aux plus essentielles, vont soit disparaître, soit voir leur prix grimper en flèche. Le prix de l’iPhone, par exemple, qui est fabriqué en Chine, passerait d’environ 1000 dollars à 1800 dollars, voire 2000 dollars, dépendamment de l’ampleur du choc qu’Apple est prêt à absorber. Selon The Economist, un iPhone fabriqué aux États-Unis pourrait même coûter jusqu’à 3500 dollars. Pas étonnant que Trump ait fait une concession de dernière minute pour les téléphones intelligents!
L’expertise manufacturière, la technologie, l’infrastructure et la main-d’œuvre qualifiée de la Chine font qu’il n’y a tout simplement pas d’autre fournisseur pour les produits manufacturés, qu’il s’agisse de produits de consommation finis comme les iPhones, ou de biens d’équipement et de pièces détachées. Selon Goldman Sachs, pour 36% des biens que les États-Unis importent de Chine, la Chine est le fournisseur dominant, répondant à plus de 70% de la demande américaine.
Le chiffre inverse n’est que de 10%, c’est-à-dire que 10% seulement des importations chinoises en provenance des États-Unis ne peuvent être achetées qu’à ce pays.
Une renaissance de l’industrie manufacturière américaine?
L’objectif de Trump étant apparemment de relancer l’industrie manufacturière américaine, il ne se soucie peut-être pas du fait que les consommateurs américains souffriront d’une forte inflation ou de rayons vides à court terme, tant que des emplois manufacturiers de haute qualité reviendront en Amérique au cours des prochaines années. Si cela devait se produire à grande échelle, peut-être que la classe ouvrière américaine ne craindrait pas de souffrir temporairement.
Le problème, c’est que l’industrie manufacturière américaine actuelle est fortement dépendante des composants chinois. Ainsi, ce qui reste de l’industrie manufacturière américaine souffrira énormément parce qu’elle ne sera plus du tout en mesure d’obtenir ces composants vitaux ou devra les payer beaucoup plus cher, étant donné qu’ils seront frappés par des tarifs. Cela rendrait ces fabricants beaucoup moins concurrentiels et, par conséquent, de nombreux emplois manufacturiers américains pourraient être perdus, ce qui est exactement le contraire de l’objectif de ces tarifs.
Le Financial Times prévoit par exemple que ces tarifs auront pour effet de rendre Tesla nettement moins concurrentiel que le constructeur chinois de véhicules électriques BYD. D’une part, BYD a commencé à se diversifier en dehors du marché américain après les premières restrictions imposées par Trump sur les véhicules électriques chinois au cours de son premier mandat. D’autre part, Tesla devra désormais payer des tarifs sur les composants importés. Si la barrière sur les importations chinoises protégera le marché intérieur, les coûts de 25% sur les composants importés désavantageront Tesla par rapport à BYD sur le marché mondial.
La réalité est que le secteur manufacturier moderne est généralement si complexe et si sophistiqué qu’il serait très difficile de rapatrier la fabrication de tous les composants aux États-Unis. Cela prendrait beaucoup de temps et d’argent, pour former les travailleurs et reconstruire la technologie et les infrastructures. Il n’est pas certain que ce soit faisable, et même si c’est le cas, il faudra attendre bien plus longtemps que le mandat de Trump pour en voir les résultats. Par exemple, on estime qu’il en coûterait pas moins de 30 milliards de dollars et que cela prendrait trois ans à Apple pour rapatrier 10% de sa chaîne d’approvisionnement de la Chine vers les États-Unis. Et même si ce rapatriement était réalisé, il se traduirait par des hausses de prix insupportables pour les consommateurs, en raison des salaires plus élevés aux États-Unis.
Ces produits entièrement fabriqués aux États-Unis ne seraient absolument pas concurrentiels sur le marché mondial, de sorte que les États-Unis continueraient à exporter un volume relativement faible de biens – et continueraient donc à enregistrer un important déficit commercial avec la Chine et le reste du monde.
La Chine, quant à elle, risque de perdre son plus grand marché à un moment où elle est confrontée à une surproduction chronique. Dans de nombreuses industries, la capacité de production de la Chine dépasse à elle seule la demande mondiale. Selon Reuters, « la capacité de production de cellules solaires de la Chine a atteint 1000 gigawatts l’année dernière, soit plus du double de la demande mondiale ». Des situations similaires existent dans de nombreux secteurs d’activité.
Le modèle économique de la Chine est peut-être très concurrentiel, mais il fait toujours partie du même marché mondial capitaliste et ne peut échapper à ses limites. Le modèle repose entièrement sur des investissements massifs dans la production industrielle afin de créer des emplois et de supplanter les concurrents. Mais la limite de ce processus, qui est en train d’être atteinte, est que le monde est inondé de produits chinois, menaçant de détruire des industries et des emplois non seulement en Amérique, mais partout ailleurs. Même la Russie, qui jouit officiellement d’une amitié « sans limites » avec la Chine, juge nécessaire d’imposer des tarifs sur les produits chinois afin de protéger ses propres industries.
Pour ces raisons, l’économie chinoise est en train de ralentir, les emplois se tarissent et le secteur du logement et de la construction, qui est d’une importance cruciale, traverse une crise profonde. La Chine est également très endettée, car ce boom des investissements a été financé sur une base capitaliste, par le biais de la spéculation. Les tarifs massifs de Trump constituent une menace sérieuse pour l’économie chinoise, car ils signifient que son problème sous-jacent – la surproduction massive – ne fera que s’aggraver, ce qui l’obligera soit à trouver de nouveaux marchés ailleurs, soit à fermer des usines et à licencier des millions de travailleurs.
Si les tarifs restent en place, l’économie américaine est en revanche menacée de pénuries chroniques, d’inflation et de pertes d’emplois. Aucune des parties ne « gagnera » cette guerre commerciale, car ces économies sont les deux faces d’un même système capitaliste condamné. Toutefois, dans l’ensemble, c’est la Chine, et non les États-Unis, qui a les meilleures cartes en main. Selon Arthur Kroeber, du Financial Times, « la dépendance des États-Unis à l’égard des intrants industriels chinois est trois fois supérieure à la dépendance de la Chine à l’égard des composants américains. La hausse des prix des intrants nuit déjà aux investissements des entreprises. »
Ces pénuries menacent l’ensemble de l’activité économique des États-Unis, des jouets aux vêtements, en passant par les terres rares, les aimants de haute technologie et tout ce qui concerne les circuits électriques et les processeurs. Couper complètement l’économie américaine de celle de la Chine, comme les tarifs tentent de le faire, causerait de très graves dommages économiques aux États-Unis.
L’autre déficit
La dette du gouvernement américain s’élève à 36 000 milliards de dollars, soit environ 124% de son PIB. Il s’agit de loin de la dette la plus importante au monde. En proportion du PIB, elle est également l’une des plus élevées.
Cette dette est étroitement liée à l’énorme déficit commercial des États-Unis. Tous deux sont le résultat d’une baisse de la compétitivité américaine sur le marché mondial. L’une des raisons pour lesquelles la dette est si élevée est que les recettes fiscales ne sont pas assez importantes. Le niveau d’imposition d’une économie est fonction de sa vigueur : si les profits et les exportations sont en plein essor, l’imposition peut être plus élevée.
Parce que la consommation américaine est si élevée, par rapport à sa production et aux autres économies capitalistes, le marché américain est le premier marché du monde. Les États-Unis possèdent également les monopoles financiers dominants et les plus grands marchés de capitaux du monde. Tous ces éléments font que le dollar américain est, et a été pendant de nombreuses décennies, la « monnaie de réserve » du monde, représentant un « refuge » pour la finance mondiale.
Le capitalisme a objectivement besoin d’un « refuge » contre les turbulences et l’incertitude du marché. Une fois que le capitalisme américain est devenu dominant dans l’économie mondiale, les capitalistes ont commencé à voir l’État américain comme extrêmement fiable : il ne ferait pas défaut sur ses dettes, parce qu’il était si fort économiquement, politiquement et militairement. Une fois qu’il a été reconnu comme tel, son statut de « refuge » a été renforcé dans une sorte de boucle de rétroaction. Parce que les capitalistes savaient qu’il avait ce statut, ils savaient que d’autres capitalistes continueraient à lui prêter de l’argent en toute confiance, ce qui rendait encore plus improbable qu’il ait un jour des difficultés à payer ses dettes.
C’est pourquoi la part des États-Unis dans la « capitalisation boursière mondiale », c’est-à-dire la proportion d’actions mondiales provenant de l’économie américaine, est d’environ 65%, alors que leur part du PIB mondial n’est que de 25%. Pourquoi sa part dans les marchés boursiers mondiaux est-elle si disproportionnée par rapport à son économie? Principalement parce que le commerce et la finance mondiaux ont besoin de ce « refuge » et de ces lubrifiants que les bons du Trésor américain (c’est-à-dire les obligations de la dette fédérale) et le dollar américain ont fini par représenter. Mais les fondements économiques qui sous-tendent cette fiabilité se sont considérablement atrophiés.
Cette situation a également donné au gouvernement américain le « privilège exorbitant » (comme on l’appelle) de pouvoir emprunter beaucoup plus qu’il ne pourrait le faire autrement, à des taux d’intérêt très bas. Il a pu exploiter son statut de refuge pendant longtemps.
C’est pourquoi la dette du gouvernement américain est si importante. Le gouvernement américain a pu vivre au-dessus de ses moyens pendant des décennies grâce à sa position unique de centre du commerce mondial et de plus grand marché du monde.
Pour ces raisons, ce « privilège » est inextricablement lié à l’énorme déficit commercial des États-Unis. Les États-Unis ont essentiellement emprunté aux pays qui leur vendent des marchandises (principalement la Chine) et utilisé cet argent emprunté pour acheter davantage de marchandises à ces mêmes pays. Cette situation est totalement insoutenable et constitue une contradiction centrale de l’économie mondiale.
C’est également la raison pour laquelle un déficit commercial massif ne signifie pas que les États-Unis ont le meilleur jeu dans une guerre commerciale.
La domination du dollar
Il semble que c’est précisément cette contradiction qui a poussé Trump à réduire les tarifs qu’il avait imposés à la plupart des pays du monde la semaine dernière, à l’occasion de son « Jour de la Libération ». En imposant d’énormes tarifs au reste du monde, les États-Unis menaçaient leur statut en tant que principal refuge financier mondial, pour un certain nombre de raisons.
Cela signifiait que les capitalistes ne pouvaient pas faire confiance à la stabilité et à l’« ouverture » de l’État américain. Rappelons que les actions américaines représentent environ 65% du marché mondial des actions – parce que les capitalistes estiment que l’économie américaine est stable, que l’« État de droit » y est sacro-saint, c’est-à-dire que le gouvernement ne mettra pas soudainement en œuvre des politiques contraires aux intérêts des capitalistes, parce qu’il « respecte » tellement la propriété privée. Soudain, tout cela a été menacé. Par exemple, la semaine dernière, de grands fonds de pension canadiens et danois ont annoncé qu’ils se retiraient du marché américain, précisément en raison de la volatilité politique du pays.
L’effet sur le dollar, les marchés boursiers américains et le marché obligataire « ressemble à une bonne vieille fuite des capitaux ». Pour la première fois depuis très longtemps, les capitaux mondiaux n’affluaient pas vers l’économie américaine – comme cela avait toujours été le cas auparavant lorsque les capitalistes étaient confrontés à des eaux troubles – mais en sortaient. Depuis le « Jour de la Libération », la valeur du dollar a chuté et continue de chuter.
Trump peut bien souhaiter un dollar plus faible, car cela rendrait les exportations américaines moins chères et stimulerait donc l’industrie manufacturière américaine. Mais il ne veut pas, et ne devrait certainement pas vouloir, que le dollar perde son statut de monnaie de réserve mondiale. Le 30 novembre de l’année dernière, il a clairement indiqué qu’il comprenait à quel point il était crucial que le dollar conserve son statut, lorsqu’il a tweeté ce qui suit :
« L’idée selon laquelle les Pays du BRICS essaient de s’éloigner du Dollar pendant que nous restons les bras croisés est RÉVOLUE. Nous exigeons de ces Pays qu’ils s’engagent à ne pas créer une nouvelle Monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre Monnaie pour remplacer le puissant Dollar américain, faute de quoi ils seront soumis à des Tarifs de 100% et devront s’attendre à dire adieu à vendre dans la merveilleuse Économie américaine. Qu’ils trouvent un autre “nigaud”! Il n’y a aucune chance que les BRICS remplacent le Dollar américain dans le commerce international, et tout Pays qui s’y essaiera devra dire adieu à l’Amérique. »
Le dollar n’est pas sur le point d’être remplacé par une autre monnaie en tant que réserve mondiale. Mais elle est peut-être sur le point de perdre sa position de domination totale, et la dette publique américaine deviendrait alors beaucoup plus chère.
En effet, la semaine dernière, les taux d’intérêt sur la dette publique américaine ont augmenté à son rythme le plus rapide depuis les années 1980. Le gouvernement japonais a apparemment vendu des bons du Trésor américain en grand nombre, ce qui a fait monter le taux d’intérêt pour les États-Unis. La menace que la Chine commence à faire de même est imminente, et elle est le deuxième plus grand détenteur de la dette américaine en dehors des États-Unis. Il n’est peut-être pas nécessaire qu’elle commence à vendre pour obtenir cet effet : elle peut simplement cesser d’acheter de la dette publique américaine, ce qui, à long terme, serait désastreux pour les États-Unis.
Le samedi 12 avril, Forbes a cité les propos d’un expert des opérations sur le change à la banque multinationale néerlandaise ING : « La question d’une potentielle crise de confiance envers le dollar a maintenant trouvé une réponse définitive : nous sommes en train d’en vivre une de plein fouet. »
L’économie américaine, et par extension, l’économie mondiale, survit depuis des décennies grâce à une sorte de tour de passe-passe. Tant qu’elle peut continuer à emprunter pour maintenir son marché au centre de l’économie mondiale, elle peut continuer à emprunter pour maintenir son marché. Le moment où ce tour de passe-passe ne fonctionne plus est comme le moment où le Coyote des Looney Tunes regarde en bas et réalise qu’il court dans le vide. Il s’ensuit une chute vertigineuse.
Si les États-Unis ne peuvent plus continuer à emprunter à des taux d’intérêt bas, ils seront confrontés à une véritable crise financière, mettant le gouvernement en situation de défaut de paiement, à moins qu’il ne s’engage dans une politique d’austérité massive. Or, le programme de Trump est de mettre en œuvre d’importantes réductions d’impôts dans quelques mois, ce qui accentuerait encore la pression sur le déficit et entraînerait probablement une nouvelle hausse des taux d’intérêt que le gouvernement doit payer.
Un défaut de paiement des États-Unis déclencherait à son tour une crise mondiale qui pourrait rapidement se transformer en une nouvelle dépression, et les États-Unis ne disposeraient plus des outils financiers nécessaires pour renflouer le système financier, comme en 2008. Un défaut de paiement pourrait bien être évité, mais les moyens d’y parvenir, tels que la planche à billets, auraient leurs propres conséquences très graves pour les États-Unis et l’économie mondiale, telles qu’une inflation massive et un effondrement de la confiance dans le capitalisme américain.
Trump est-il fou?
Les libéraux brandissent la crise qu’il semble avoir déclenchée comme la preuve que Trump n’a pas de plan, ne comprend rien et a commis une énorme « erreur non provoquée ».
Il ne s’agissait pas d’une erreur non provoquée, mais d’une accélération des processus politiques et économiques objectifs déjà en cours, qui reflète l’impasse du capitalisme en général et, en particulier, le déclin relatif de l’impérialisme américain.
Il est bien connu que la politique la plus « bipartisane » à Washington est celle qui consiste à utiliser les tarifs et les restrictions au commerce pour freiner la Chine. Les deux ailes de la classe dirigeante américaine y sont favorables, et l’administration Biden a mené une guerre économique massive contre la Chine. Ce sont les restrictions imposées par Biden sur les exportations vers la Chine qui ont eu pour conséquence involontaire d’affaiblir la position de Trump dans cette guerre commerciale. Cela a poussé les Chinois à consacrer d’énormes ressources, au cours des quatre dernières années, à l’intensification des échanges avec d’autres pays et au développement de leurs propres capacités technologiques (pour contourner les restrictions imposées à la vente de certaines technologies à la Chine). Cela a eu pour effet de mieux protéger la Chine contre le type de guerre commerciale que Trump mène actuellement.
La Loi sur la réduction de l’inflation de Biden a également été largement comprise comme une forme de guerre économique protectionniste contre l’Europe. C’est l’administration Biden qui a provoqué la guerre avec la Russie en Ukraine, dont l’objectif était en partie d’affaiblir l’Europe (en particulier l’Allemagne) en creusant un fossé économique entre elle et la Russie. Cela a eu des conséquences terribles pour l’Europe, mais aussi pour l’impérialisme américain, puisque la Russie est en train de gagner cette guerre.
Les administrations américaines, les unes après les autres, ont exploité le statut dominant du dollar en appliquant des sanctions à tous leurs ennemis. Celles-ci ne fonctionnent (dans la mesure où elles fonctionnent réellement) qu’en raison de la centralité du marché américain et de ses institutions financières : lorsque les États-Unis appliquent des sanctions, ils peuvent compter sur le respect des règles par les entreprises du monde entier. Si elles ignorent les sanctions, ce qu’elles ont le droit de faire, elles sont coupées du marché américain et de l’ensemble du système financier mondial, que les États-Unis contrôlent par l’intermédiaire de SWIFT. La menace susmentionnée de Trump à l’égard des pays des BRICS n’est qu’une expression plus grossière de la même tactique que les gouvernements américains utilisent depuis des décennies.
Le problème, c’est qu’à long terme, appliquer constamment des sanctions finit par encourager les autres pays à commencer à mettre en place des solutions de rechange au système financier américain. C’est pourquoi la Chine et la Russie développent des instruments financiers alternatifs afin de permettre aux entreprises et aux gouvernements d’effectuer des paiements en contournant complètement le système financier américain.
En fait, la domination du dollar commençait déjà à décliner avant que Trump ne revienne au pouvoir, et avec elle, le taux d’intérêt sur la dette du gouvernement américain augmentait.
Comme l’a souligné l’Institut pour la recherche sur les politiques économiques de l’université Stanford :
« La valeur des bons du Trésor en circulation a chuté de 26% entre 2020 et 2023, l’une des plus fortes baisses depuis la Première Guerre mondiale. Pour tenter de stabiliser le marché des bons du Trésor pendant la pandémie, la Fed est intervenue avec ce que Lustig qualifie de quantité “stupéfiante” d’achats de bons du Trésor. Pendant plusieurs trimestres, de 2020 à 2022, la Fed a acheté tous les bons du Trésor à long terme émis par le gouvernement américain. Mais lorsqu’elle a cessé ses achats, les rendements se sont envolés et les prix ont chuté. »
La colère de classe monte
Trump a gagné l’élection parce que le capitalisme américain est en crise. La haine de l’establishment et du statu quo est largement répandue, et la classe ouvrière américaine déteste la mondialisation et la désindustrialisation qu’elle a entraînée. Cette humeur a des causes objectives de longue date et ne peut être ignorée. Les libéraux apparemment « rationnels » et « raisonnables » n’ont pas de réponse à cette colère de classe et sont responsables de sa montée.
Les idées de Trump sur les négociations commerciales, qui font l’objet d’une intense spéculation, sont d’importance secondaire. Trump est arrivé au pouvoir en promettant à cette classe ouvrière en colère une rupture fondamentale avec les politiques qui ont conduit à des décennies de stagnation des salaires, de désindustrialisation, d’endettement et d’augmentation des inégalités.
À la différence des politiciens libéraux, Donald Trump s’efforce de tenir ses promesses, sans les diluer. S’il recule maintenant dans cette guerre commerciale, toute sa campagne, son mouvement, ses promesses et les espoirs qu’il a suscités n’auront servi à rien. Le statu quo, l’« État profond », les « mondialistes », comme il les appelle, auront gagné. L’homme fort qui dit aux gens de « se battre jusqu’au bout » aurait capitulé dès le premier combat. Le monde entier saurait que la puissance et la confiance qu’il projette, sur lesquelles il fait reposer sa position de négociation, ne sont qu’un coup de bluff. Il a donc fortement intérêt à ne pas céder.
Cependant, avec Xi Jinping et l’économie chinoise, la « force irrésistible » de Trump rencontre un objet inamovible. Si Xi Jinping devait plier pour retrouver l’accès au marché américain, il dirait au monde que la Chine peut être et sera intimidée. Elle renoncerait à toute prétention d’être une puissance capable de remplacer les États-Unis dans la région du Pacifique.
La crédibilité politique de Xi Jinping en Chine repose sur sa capacité à mettre enfin la Chine en position de défier les États-Unis. Son régime mobilise une rhétorique nationaliste depuis un certain temps pour gagner des appuis. Il se prépare à une telle confrontation avec les États-Unis depuis longtemps, et le peuple chinois le sait.
Les Chinois éprouvent un profond sentiment d’humiliation face aux Occidentaux et à l’arrogance dont ils font preuve. Ils voient très clair dans le jeu des États-Unis : la tentative d’une puissance impérialiste en difficulté de contenir la Chine et de la maintenir dans la pauvreté. Le Parti communiste chinois a toujours fondé sa crédibilité sur sa posture anti-impérialiste (même si la Chine est en fait elle-même une puissance impérialiste aujourd’hui) et sur sa capacité à mener la Chine vers une position de force et d’indépendance.
Si, dans ce contexte, Xi donne à Trump plus ou moins ce qu’il veut, cela nuirait gravement au régime de Xi, d’autant plus que ce sont les Américains qui ont lancé cette guerre commerciale et qui sont à blâmer. Les commentaires de JD Vance, cités plus haut, contribuent à donner à Xi une position politique forte; ils aident à vendre l’idée de difficultés économiques temporaires en Chine – qui, après tout, seraient la faute de ces Occidentaux arrogants – afin que la Chine puisse porter un coup puissant à l’ennemi.
L’art de négocier
Un accord entre la Chine et les États-Unis finira très probablement par être conclu : les enjeux sont trop importants pour qu’il n’en soit pas ainsi. Mais les actions de Trump et la faiblesse relative des États-Unis dans cette situation ont fait monté les enjeux et rendu beaucoup plus difficile de trouver un accord sans qu’il ne perde gravement la face.
Lorsque la classe ouvrière américaine constatera que le programme de l’« Amérique d’abord » tant vanté ne signifie pas le retour d’emplois bien rémunérés et un « nouvel âge d’or de l’Amérique », comme l’a récemment promis Trump, mais une grave crise économique ou une capitulation embarrassante face à la Chine – ou une combinaison des deux – elle sera encore plus en colère qu’avant. Penser qu’ils vont simplement accepter cela calmement, comme s’ils se réveillaient d’un délire collectif, et revenir au statu quo promis par les démocrates, serait le plus grand des délires.
Le déclin de l’impérialisme américain et la crise aiguë du capitalisme qui en découle signifient que, d’une manière ou d’une autre, la classe ouvrière n’aura d’autre choix que de lutter pour ses propres intérêts. Non pas « l’Amérique d’abord », mais « la classe ouvrière d’abord » sera sa revendication.
Il s’agit de la guerre commerciale la plus grave depuis les années 1930, voire de tous les temps. Elle indique non pas la folie de Trump, mais l’impasse du capitalisme. Le monde n’est pas assez grand pour les puissances impérialistes américaine et chinoise. De source de croissance pour le monde, leur relation menace désormais l’ensemble du système capitaliste mondial. Il n’y a pas de solution sur une base capitaliste. Le seul moyen d’avancer est de retirer l’économie mondiale des mains des milliardaires parasites qui la découpent et la redécoupent entre eux, et de la remettre entre les mains des travailleurs du monde entier.