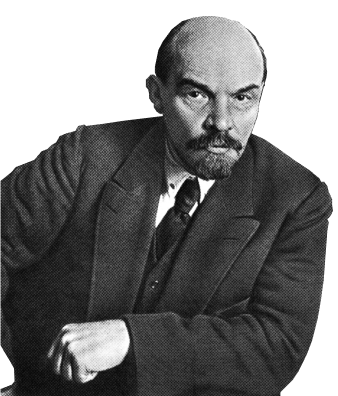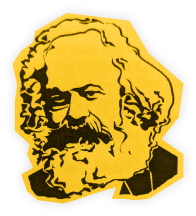Lorsque Carney est arrivé au pouvoir, bien des gens pensaient que son expérience de banquier signifiait qu’il était le mieux placé pour gérer la crise économique déclenchée par les tarifs de Trump. Mais il faut se rendre à l’évidence : Carney n’a aucune solution, et l’économie canadienne court tout droit vers la catastrophe.
La dépendance aux États-Unis
Pendant des décennies, le succès du capitalisme canadien dépendait des États-Unis. Avec 80% des exportations typiquement envoyées là-bas, les tarifs de Trump représentent une menace existentielle pour les industries principales du pays. Le bois d’œuvre, le secteur manufacturier, l’acier et l’aluminium, entre autres, pourraient être détruits.
Conscient de la gravité de la situation économique, Carney a souvent affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une « transition », mais d’une « rupture ». Et c’est bien vrai. Ce qui était autrefois une énorme force s’est transformé en talon d’Achille de l’économie canadienne.
Alors que l’impérialisme américain abandonne le soi-disant ordre mondial libéral établi après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada se trouve parmi les plus grands perdants. Une analyse récente de Moody’s montre que l’économie canadienne avait tendance à bénéficier de la prospérité américaine, mais que c’est de moins en moins le cas.
Et tandis que Trump accélère cette tendance, celle-ci existait bien avant. Comme le note ce rapport, le PIB canadien et américain grandissait plus ou moins au même rythme entre 2010 et 2017 (18 et 20% respectivement). Mais depuis 2022, les choses ont changé. Tandis que le PIB américain a crû de 6,7%, le Canada affiche un maigre 3,6%.

Implosion industrielle
Au cœur de la crise économique se trouve le déclin de l’industrie canadienne. Tandis que la Chine s’est transformée en puissance industrielle et exportatrice de masse, les États-Unis tentent de protéger leurs industries et ne se soucient guère de celles de ses alliés d’autrefois en Europe et au Canada, pris entre le marteau et l’enclume.
Le marché canadien a connu un exode des investissements en capital, tant canadiens qu’étrangers. Theo Argitis, vice-président principal des politiques au Conseil canadien des affaires, l’explique ainsi : « Nous vivons dans un monde où le capital se fait de plus en plus rare; la concurrence pour les capitaux est très forte. »
Le résultat, c’est ce que la Banque Nationale appelle une « implosion industrielle ». Tandis que les investissements dans les équipements et les machines industriels ont augmenté régulièrement aux États-Unis, ils ont chuté à leur plus bas niveau historique au Canada. Cela a entraîné une crise de la productivité du travail. Depuis 2022, la productivité du travail aux États-Unis a augmenté de 5,6%, tandis qu’elle a diminué de 1,2% au Canada. Les droits de douane ont accéléré ce processus, la productivité du travail ayant chuté de 1% au deuxième trimestre, alors que l’économie se contractait de 1,6%.

Partout en Ontario, la production automobile freine et des usines ferment, entraînant la perte de milliers d’emplois. Sans leur accès libre au marché américain, des entreprises comme GM et Stellantis déplacent leurs usines vers le sud de la frontière.
Une crise similaire frappe l’acier, l’aluminium et le bois d’œuvre. Même des industries qui ne sont pas directement ciblées par Trump ont souffert du changement dans les relations entre les deux pays. Par exemple, Air Canada vient de supprimer des centaines d’emplois alors que le nombre de ses vols vers les États-Unis a chuté.
Comme l’affirme de façon sinistre Jason Jacques, le Directeur parlementaire du budget, l’économie est « au bord du précipice ».
Pour la classe ouvrière, le coup est dur. Le taux de chômage atteint 7,1%, son plus haut niveau depuis la pandémie, et le chômage des jeunes est à presque 15%, un sommet en 15 ans. Alors que le capital fuit l’économie canadienne, le nombre d’emplois disponibles est à son plus bas en huit ans. Sans surprise, selon Statistique Canada, l’inégalité entre les riches et les pauvres atteint son plus haut depuis que ces statistiques existent.
Carney impuissant
Carney avait promis de tenir tête à Trump. Il promettait de diversifier les partenaires commerciaux et de diminuer la dépendance envers les États-Unis. Il promettait de bâtir un « corridor énergétique est-ouest » et de faire du Canada une « superpuissance énergétique ».
Démontrant une bonne dose d’optimisme utopiste, Carney affirmait qu’il ferait du Canada « l’économie du G7 avec la plus grande croissance ». Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, allait jusqu’à dire qu’il était possible de rebâtir l’économie et de déclencher un nouveau boom économique semblable à celui ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale.
Ce ne sont là que des vœux pieux.
Le boom d’après-guerre était une anomalie résultant des conditions particulières résultant de la guerre. La destruction causée par la guerre a entraîné une crise massive de sous-production, créant ainsi les conditions d’une reprise économique sans précédent. De plus, les États-Unis se sont imposés au monde comme puissance capitaliste unipolaire, faisant largement tomber les barrières commerciales.
Mais aujourd’hui, la situation est à bien des égards l’exact opposé. Nous ne vivons plus dans le monde unipolaire d’autrefois; les États-Unis doivent composer avec d’autres puissances, notamment la Chine, son principal rival sur le plan économique.
Il y a une énorme crise de surproduction qui affecte l’ensemble du système, et différentes puissances capitalistes luttent pour des parts de marché. Dans ce contexte, le Canada ne peut plus simplement se mettre à la remorque des États-Unis, eux qui laissent tomber leurs vieux alliés au nom de « l’Amérique d’abord ».
Carney n’a pas de baguette magique permettant de faire disparaître cette réalité matérielle. Bien qu’il ait beaucoup parlé de diversification des partenaires commerciaux, il sera ultimement impossible de remplacer le marché américain, particulièrement dans des conditions de protectionnisme généralisé. Déjà, l’agriculture canadienne souffre des tarifs chinois sur le canola et des tarifs de l’Inde sur les pois jaunes.
C’est encore pire pour l’acier, l’aluminium et l’automobile. Le problème découle du fait que les véhicules et l’acier canadien et américain (entre autres) ne peuvent pas concurrencer leurs équivalents chinois.
Les bourgeois plus clairvoyants s’en rendent comptent et recommandent à Carney de rompre le pain avec Trump. Par exemple, dans un article intitulé « Les Canadiens feraient mieux d’écouter ce que l’ambassadeur américain a à dire », le président du Conseil canadien des affaires, Goldy Hyder, écrit : « Bien des choses ont changé depuis l’an dernier, mais deux d’entre elles sont restées les mêmes : la géographie et les mathématiques. Ces chaînes d’approvisionnement hautement intégrées vont du nord au sud, et la vérité indéniable est qu’aucune espèce de diversification ne peut remplacer la valeur et le volume de marchandises que celles-ci transportent, du moins pas de notre vivant. »
Il met ainsi de l’avant la perspective d’une augmentation du commerce et des investissements entre les deux pays résultant des renégociations de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique l’an prochain. Mais cela semble improbable sans faire d’énormes concessions à Trump.
C’est pourquoi, loin de lutter contre Trump, Carney se plie en quatre devant Trump et lui lèche les bottes, tout en lui offrant une concession après l’autre. Il a supprimé les droits compensatoires et éliminé la taxe sur les services numériques qui visait les géants américains de la tech. Même ses dépenses militaires et ses changements à la frontière sont des capitulations évidentes devant Trump.
Afin de justifier l’augmentation énorme des dépenses militaires, Carney affirme qu’elles mettront « en place des chaînes de fabrication et d’approvisionnement à l’échelle nationale et [créeront] de nouvelles carrières ». Mais ces dizaines de milliards de dollars contribueront de façon négligeable à l’industrie canadienne puisque la majorité de ces dépenses ira à des compagnies basées aux États-Unis.
Carney se bute aux mêmes barrières internes auxquelles Trudeau faisait face avant lui. Malgré ses appels à construire un « corridor énergétique est-ouest », aucune entreprise privée ne se montre intéressée par un tel projet.
C’est ce qui a mené le gouvernement albertain à se proposer comme bailleur de fonds initial pour un nouvel oléoduc, une proposition rejetée par le gouvernement de Colombie-Britannique et par des groupes autochtones. Donc, plutôt que de bâtir des infrastructures énergétiques de l’est à l’ouest pour réduire la dépendance envers les États-Unis, Carney a ouvert la porte à faire renaître le projet d’oléoduc Keystone XL qui transiterait par les États-Unis – ce qui ne va qu’accentuer la dépendance envers ceux-ci.
L’inévitable lutte des classes
La conclusion est inévitable : un désastre absolu s’en vient, et le gouvernement n’a aucune solution. Et c’est nous, les travailleurs, qui en souffriront à coups de pertes d’emploi et de coupes dans les services sociaux.
Le budget annoncé par Champagne prévoit des coupes de 40 000 postes dans la fonction publique. Dans le secteur privé, la situation est pire encore.
Dans ce climat d’investissement, avec l’effondrement du commerce mondial et une compétition féroce, le Canada n’est tout simplement pas un marché compétitif où placer son argent. C’est pourquoi bien des entreprises s’en retirent en quête de marchés plus profitables.
Pour comprendre ce problème, prenons le Régime de pensions du Canada, dont seulement 12% du fonds est investi au Canada. John Graham, le président et chef de la direction de ce fonds de 730 milliards de dollars, explique pourquoi : « le capital est fluide et agit en mercenaire. Il ira toujours vers les opportunités qui offrent le moins de résistance. »
Ainsi, pour attirer l’investissement en capital, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent éliminer autant de barrières que possible. Cela inclut les réglementations, les taxes et le coût de la main-d’œuvre. Carney a déjà supprimé de nombreuses réglementations environnementales. Son dernier budget élimine la taxe sur les produits de luxe et prévoit d’importantes déductions fiscales pour les entreprises dans le cadre de ce qu’ils appellent la « superdéduction à la productivité ».
Le mouvement ouvrier se trouvera inévitablement dans le collimateur. Les capitalistes doivent réduire le coût des salaires et des avantages sociaux. Les droits syndicaux sont violés de tous côtés par les gouvernements fédéral et provinciaux, car ils ne peuvent plus tolérer de hauts salaires et avantages sociaux, ni les perturbations économiques engendrées par les grèves.
Une austérité massive, des fermetures d’usines et des suppressions d’emplois dans le secteur public sont à l’horizon.
La lutte des classes s’en vient, et il faut s’y préparer.