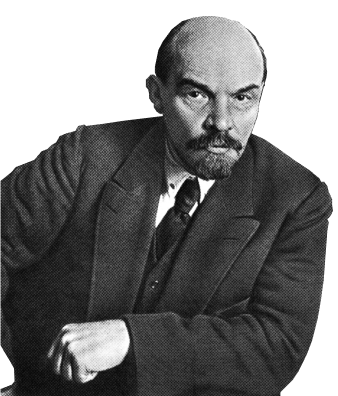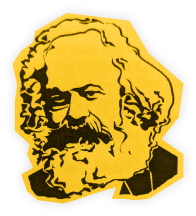Des événements considérables sont en train de transformer le monde tel que nous le connaissons. Avec Trump qui provoque des bouleversements politiques et économiques à l’échelle mondiale, les contradictions accumulées au cours de près de deux décennies de crise et de stagnation capitalistes atteignent leur paroxysme. Du génocide à Gaza à la défaite de l’Occident en Ukraine, en passant par la hausse des tarifs douaniers et l’explosion de la dette mondiale, des événements historiques ébranlent la conscience de milliards de personnes.
Pour évaluer cette situation, l’Internationale communiste révolutionnaire (ICR) convoquera son tout premier Congrès mondial en Italie dans huit semaines. Les délégués et les invités y mèneront des discussions approfondies sur cette version préliminaire de notre document sur les perspectives mondiales, approuvée par notre Comité exécutif international. Pour naviguer dans les méandres de la situation mondiale, une compréhension claire de la période actuelle est essentielle – sans elle, une organisation révolutionnaire est comme un navire sans boussole.
Au cours des deux dernières années, l’ICR a connu une croissance exponentielle. Nous sommes désormais présents dans 70 pays à travers le monde. Le Congrès mondial marquera une étape cruciale dans la préparation de notre Internationale aux chocs titanesques, aux luttes de classes et aux bouleversements révolutionnaires qui se profilent à l’horizon.
Nous vivons une période de virages brusques et de changements soudains dans la situation mondiale. L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et la politique qu’il a mise en œuvre ont introduit une énorme instabilité dans la politique mondiale, l’économie mondiale et les relations entre les puissances.
Trump n’est pas à l’origine de cette instabilité. Elle est le résultat de la crise du capitalisme, mais ses actions ont énormément accéléré le processus. Des contradictions qui s’accumulaient depuis longtemps sous la surface ont soudainement éclaté au grand jour, bouleversant toute la situation. Le soi-disant ordre mondial libéral, qui a prévalu pendant des décennies, s’effondre maintenant sous nos yeux.
Pour analyser la situation mondiale, il faut partir des fondamentaux. Le capitalisme est un système qui a depuis longtemps dépassé son rôle historique. Dans sa phase de décomposition, il produit des guerres, des crises et des catastrophes environnementales qui, à long terme, menacent l’existence même de la vie sur la planète. L’objectif de ce document est de présenter les principales caractéristiques de cette crise et de souligner la nécessité de construire une organisation révolutionnaire capable de renverser ce système, seul moyen de garantir un avenir à l’humanité.
En dernière analyse, la crise est causée par l’incapacité du système capitaliste à développer les forces productives. L’économie est enfermée dans les limites de l’Etat-nation et de la propriété privée des moyens de production. Pendant des décennies, les capitalistes ont utilisé diverses méthodes pour tenter de surmonter ces limites : augmentation des liquidités, développement du commerce mondial, etc. Toutes ces mesures se transforment aujourd’hui en leur contraire.
L’élection de Trump
L’élection de Donald Trump en novembre 2024 a représenté un bouleversement politique important, et une expression de la crise de légitimité de la démocratie bourgeoise. Ce dernier élément n’est pas propre aux Etats-Unis mais existe dans tous les pays. Malgré les efforts considérables déployés par la principale fraction de la classe dirigeante et de l’establishment américains pour empêcher sa victoire, Trump a obtenu une victoire décisive.
Ce résultat a été largement interprété, en particulier par les commentateurs libéraux, les médias grand public et les sections de la « gauche », comme la preuve d’un glissement plus large vers la droite de la politique américaine et mondiale.
Ces « explications » sont superficielles et trompeuses. En outre, elles nous invitent à tirer des conclusions extrêmement dangereuses. Par exemple, Joe Biden et les Démocrates représenteraient en quelque sorte une alternative plus progressiste et « démocratique », ce qui est en totale contradiction avec les faits.

L’administration Biden était totalement réactionnaire, ce qui était particulièrement évident dans le domaine de la politique étrangère. Rappelons que « Génocide Joe » a donné carte blanche à Netanyahou pour massacrer les Palestiniens de Gaza. Il a mené une campagne de répression féroce contre les étudiants et autres personnes qui ont osé s’opposer à cette politique réactionnaire.
De même, dans le cas de l’Ukraine, il a délibérément provoqué un conflit qui a conduit à un massacre sanglant, en remettant des milliards de dollars en espèces et en aide militaire au régime réactionnaire de Kiev, et en menant une dangereuse politique de provocation contre la Russie qui a amené les Etats-Unis au bord de la Troisième Guerre mondiale.
Lors de la campagne électorale, Trump s’est positionné comme le « candidat de la paix », par opposition aux politiques bellicistes de la clique de Biden. Cette distinction a eu un impact particulier sur les électeurs des circonscriptions comptant d’importantes populations musulmanes et arabes.
S’il est vrai qu’une série d’éléments réactionnaires ont contribué au soutien de Trump, ces facteurs n’expliquent pas à eux seuls l’ampleur de son succès, pas plus que le fait qu’il ait augmenté son nombre de voix dans presque tous les groupes démographiques, même parmi les communautés noires et latinos de la classe ouvrière. En fait, dans plusieurs Etats où Trump a obtenu de bons résultats ou a augmenté sa part de voix, les électeurs ont simultanément approuvé des initiatives progressistes, telles que des mesures visant à protéger le droit à l’avortement ou à augmenter le salaire minimum.
Le facteur déterminant de la victoire de Trump réside dans sa capacité à exploiter, articuler et mobiliser le sentiment anti-establishment répandu et profondément enraciné dans la société américaine.
La réaction du public à l’assassinat du PDG de United Healthcare par Luigi Mangione est un exemple frappant de ce phénomène. Si l’acte lui-même était choquant, la réaction du public – marquée par la sympathie pour l’agresseur plutôt que pour la victime – était encore plus révélatrice. Mangione en est venu à être considéré par beaucoup comme une sorte de héros populaire. Il est à noter que cette réaction ne s’est pas limitée à la gauche, mais a également été partagée par une partie des conservateurs et des électeurs républicains, y compris les partisans de Trump.
Cette situation est paradoxale. Bien qu’il soit milliardaire et qu’il s’entoure d’autres milliardaires, Trump a réussi à se présenter comme l’expression de la colère anti-establishment. Cette contradiction souligne la nature incohérente et déformée de l’humeur politique actuelle. Néanmoins, elle reflète une défiance réelle et généralisée à l’égard des institutions dominantes : les grandes entreprises, les élites politiques et l’appareil d’Etat dans son ensemble.
La cause profonde de cette colère anti-establishment se trouve dans la crise du capitalisme. Elle a atteint des proportions massives depuis la crise de 2008, dont le système ne s’est pas encore totalement remis. Le soutien à la démocratie bourgeoise dans les pays capitalistes avancés s’est appuyé pendant des décennies sur l’idée que le capitalisme était capable de satisfaire certains des besoins fondamentaux de la classe ouvrière (soins de santé, éducation, pensions…) et sur l’espoir que le niveau de vie de chaque génération s’améliorerait, même légèrement, par rapport à celui de la génération précédente.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Aux Etats-Unis, en 1970, plus de 90 % des personnes âgées de 30 ans gagnaient un revenu supérieur à celui de leurs parents au même âge. Toutefois, en 2010, ce pourcentage était tombé à 50 %. En 2017, seuls 37 % des Américains prévoyaient que leurs enfants atteindraient un meilleur niveau de vie qu’eux-mêmes.
Selon le Bureau des statistiques du travail, depuis le début des années 1980, les salaires réels des Américains de la classe ouvrière sont restés inchangés ou ont diminué, notamment en raison de l’externalisation des emplois vers d’autres pays. De même, l’Economic Policy Institute rapporte que les salaires des ménages à revenus faibles et moyens n’ont connu que peu ou pas de croissance depuis la fin des années 1970, alors que le coût de la vie n’a cessé d’augmenter.
Dans le même temps, on assiste à une polarisation obscène de la richesse. D’une part, une petite poignée de milliardaires accroît son patrimoine. D’autre part, un nombre croissant de travailleurs ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Ils sont confrontés à des mesures d’austérité, au grignotage du pouvoir d’achat des salaires par l’inflation, à l’augmentation des prix de l’énergie, à la crise du logement, etc.
Les médias, les politiciens, les partis politiques établis, les parlements, le système judiciaire, tous sont considérés à juste titre comme représentant les intérêts d’une petite élite privilégiée, prenant des décisions pour défendre leurs propres intérêts étroits et égoïstes plutôt que de servir les besoins du plus grand nombre.
La crise de 2008 a été suivie par des mesures d’austérité brutales dans tous les pays. Toutes les conquêtes du passé ont été remises en question. Les masses ont vu leur niveau de vie menacé, tandis que les banques étaient renflouées. Cela a donné lieu à une énorme colère, à des mouvements de protestation de masse et, surtout, à une crise de légitimité sans précédent de toutes les institutions bourgeoises.
Dans un premier temps, cet état d’esprit, illustré par les mouvements de masse contre l’austérité autour de 2011, s’est exprimé sur la gauche. Des personnalités et des partis de gauche, opposés à l’establishment, se sont développés dans toute l’Europe et aux Etats-Unis : Podemos, Syriza, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, entre autres. Pourtant, chacun de ces mouvements a fini par trahir les attentes qui avaient été suscitées. Les limites de la politique réformiste de leurs dirigeants ont été exposées.
C’est l’échec lamentable de ces personnalités de gauche qui a ouvert la voie à la montée de démagogues réactionnaires comme Trump.
Les mêmes processus sont à l’œuvre dans la plupart des pays capitalistes avancés : la crise du capitalisme, les attaques contre la classe ouvrière, la faillite de la gauche et la montée de démagogues de droite surfant sur la vague d’une humeur anti-establishment.
Danger de fascisme ou de bonapartisme?
Avant même l’élection de Trump, les médias bourgeois et la gauche ont mené une campagne bruyante pour le dénoncer comme fasciste.
Le marxisme est une science. Comme toutes les sciences, il possède une terminologie scientifique. Des mots tels que « fascisme » ont, pour nous, des significations précises. Ce ne sont pas de simples termes injurieux, ni des étiquettes que l’on peut commodément coller sur tout individu qui ne nous plait pas.
Commençons par une définition précise du fascisme. Au sens marxiste, le fascisme est un mouvement contre-révolutionnaire – un mouvement de masse composé principalement du lumpenprolétariat et de la petite bourgeoisie enragée. Il est utilisé comme une arme pour écraser et atomiser la classe ouvrière et établir un Etat totalitaire dans lequel la bourgeoisie remet le pouvoir d’Etat à une bureaucratie fasciste.
La principale caractéristique de l’Etat fasciste est une centralisation extrême et un pouvoir d’Etat absolu, dans lequel les banques et les grands monopoles sont protégés, mais soumis à un contrôle central fort par une bureaucratie fasciste vaste et puissante. Dans Qu’est-ce que le national-socialisme ?, Trotsky explique :
« Le fascisme allemand, comme le fascisme italien, s’est hissé au pouvoir sur le dos de la petite bourgeoisie, dont il s’est servi comme d’un bélier contre la classe ouvrière et les institutions de la démocratie. Mais le fascisme au pouvoir n’est rien moins que le gouvernement de la petite bourgeoisie. Au contraire, c’est la dictature la plus impitoyable du capital monopoliste. »
Telles sont, en termes généraux, les principales caractéristiques du fascisme. Quelle est la comparaison avec l’idéologie et le contenu du phénomène Trump ? Nous avons déjà eu l’expérience d’un gouvernement Trump, qui – à en croire les mises-en-garde alarmistes des Démocrates et de l’ensemble de l’establishment libéral – allait procéder à l’abolition de la démocratie. Il n’en a rien été.
Aucune mesure majeure n’a été prise pour limiter le droit de grève et de manifestation, et encore moins pour abolir les syndicats libres. Les élections se sont déroulées comme d’habitude, et finalement, même si cela s’est déroulé dans un tumulte général, c’est Joe Biden qui l’a emporté face à Trump lors de l’élection. On peut dire beaucoup de choses du premier gouvernement Trump, mais il n’avait aucun rapport avec une quelconque forme de fascisme.
Par ailleurs, l’équilibre des forces entre les classes a changé de manière significative depuis les années 1930. Dans les pays capitalistes avancés, la paysannerie, qui représentait une grande partie de la population, a été réduite à un très petit nombre, et des professions qui étaient auparavant considérées comme faisant partie de la « classe moyenne » (fonctionnaires, médecins, enseignants) se sont prolétarisées, se syndiquent et se mettent en grève. Le poids social de la classe ouvrière a été énormément renforcé par le développement des forces productives au cours de l’énorme essor économique qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L’idéologie du trumpisme – pour autant qu’elle existe – est très éloignée du fascisme. Loin de vouloir un Etat fort, l’idéal de Donald Trump est celui d’un capitalisme de libre marché, dans lequel l’Etat ne joue que peu ou pas de rôle (à l’exception de l’imposition de tarifs protectionnistes).
D’autres ont évoqué l’idée que Trump représente un régime bonapartiste. Là encore, l’idée est de dépeindre Trump comme un dictateur qui se serait engagé sur la voie de l’écrasement de la classe ouvrière. Mais cette forme d’étiquetage n’explique rien. En réalité, loin d’essayer d’écraser la classe ouvrière, Trump fait appel à elle de manière démagogique et tente de l’apaiser. Bien sûr, en tant que politicien bourgeois, il représente des intérêts fondamentalement opposés à ceux des travailleurs. Mais cela ne fait pas de lui un dictateur.
Il est possible de pointer du doigt tel ou tel élément de la situation actuelle qui peut être considéré comme un élément de bonapartisme. C’est peut-être vrai. Mais des commentaires similaires pourraient être faits sur presque tous les régimes démocratiques bourgeois récents.
Le simple fait de contenir certains éléments d’un phénomène ne signifie pas encore l’émergence réelle de ce phénomène en tant que tel. On pourrait, bien sûr, dire qu’il y a des éléments de bonapartisme présents dans le trumpisme. Mais ce n’est pas du tout la même chose que de dire qu’un régime bonapartiste existe réellement aux Etats-Unis.
Le problème est que le terme « bonapartisme » est très élastique. Il couvre un large éventail de choses, à commencer par le concept classique de bonapartisme, qui consiste essentiellement à gouverner par l’épée. Il n’est pas pertinent d’analyser ainsi l’actuel gouvernement Trump à Washington, qui, malgré ses nombreuses particularités, reste une démocratie bourgeoise. Notre tâche n’est pas d’attribuer des étiquettes aux choses, mais de suivre le processus au fur et à mesure qu’il se déroule et de comprendre ses aspects essentiels.
Des bouleversements tectoniques dans les relations mondiales
La politique étrangère de Trump représente un tournant majeur dans les relations mondiales et la fin de l’ordre mondial libéral qui a existé pendant 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Elle reconnaît le déclin relatif de l’impérialisme américain et l’existence de puissances impérialistes rivales, la Russie et surtout la Chine, son principal rival impérialiste sur la scène mondiale.
Les Etats-Unis sont sortis extrêmement renforcés de la Seconde Guerre mondiale. L’Europe et le Japon ayant été ruinés par la guerre, l’Amérique représentait 50 % du PIB mondial et 60 % de la production manufacturière mondiale. Son seul rival sérieux sur la scène mondiale était l’Union soviétique, qui était sortie renforcée de la guerre, ayant vaincu l’Allemagne nazie et progressé sur le continent.
La révolution chinoise a encore renforcé le bloc stalinien. Les Etats-Unis s’efforcèrent de reconstruire l’Europe occidentale et le Japon afin de contenir « l’avancée du communisme ». La bureaucratie soviétique n’était pas intéressée par la révolution mondiale et était tout à fait disposée à conclure un modus vivendi avec Washington, exprimé dans la politique de « coexistence pacifique ».

S’ensuivit une période d’équilibre relatif entre les Etats-Unis et l’URSS, deux puissances nucléaires, connue sous le nom de « guerre froide ». Sur la base de la domination américaine, une série d’institutions formellement multilatérales furent créées pour gérer les relations mondiales (les Nations unies) et l’économie mondiale (le FMI et la Banque mondiale créés lors de la conférence de Bretton Woods). Cet équilibre fut renforcé par l’essor économique de l’après-guerre, période de développement extraordinaire des forces productives et du marché mondial.
Cette période a duré jusqu’à l’effondrement du stalinisme en 1989-1991 et la restauration du capitalisme en Russie et en Chine. La situation mondiale a alors connu un nouveau tournant majeur. Les Etats-Unis sont devenus la puissance impérialiste dominante et incontestée.
La guerre impérialiste de 1991 contre l’Irak a été menée sous les auspices de l’ONU, la Russie votant pour et la Chine s’abstenant simplement. La domination de l’impérialisme américain ne semblait rencontrer aucune opposition. D’un point de vue économique, Washington a encouragé la mondialisation et le « néolibéralisme », c’est-à-dire la poursuite de l’intégration du marché mondial, sous la domination de l’impérialisme américain, et le recul de l’Etat.
Cette période de domination sans entraves de l’impérialisme américain s’est lentement érodée au cours des 35 dernières années, au point qu’une situation totalement nouvelle est apparue aujourd’hui.
Poussés par leur suprême arrogance, les Etats-Unis ont lancé les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan. Mais là, l’histoire a commencé à s’inverser. Les Américains se sont enlisés dans ces guerres ingagnables pendant 15 ans, ce qui leur a coûté cher en termes de dépenses et de pertes de personnel. En août 2021, ils ont été contraints à une humiliante retraite d’Afghanistan.
Ces expériences ont laissé le public américain réticent aux aventures militaires à l’étranger et la classe dirigeante américaine très prudente quant à l’engagement outre-mer de troupes terrestres. Avec la montée de nouvelles puissances régionales et mondiales, l’équilibre relatif des forces à l’échelle mondiale était en train de changer. L’impérialisme américain n’a rien appris de ces expériences. Il a refusé d’admettre le nouvel équilibre des forces et s’est efforcé de maintenir sa domination, s’empêtrant ainsi dans toute une série de conflits qu’il n’a pas pu remporter.
Un monde multipolaire ?
La situation mondiale est dominée par une énorme instabilité des relations mondiales. C’est le résultat de la lutte pour l’hégémonie mondiale entre les Etats-Unis, la plus grande puissance impérialiste du monde, qui connaît un déclin relatif, et la Chine, une puissance impérialiste montante, plus jeune et plus dynamique. Nous assistons à un formidable changement, comparable, par son ampleur, au mouvement des plaques tectoniques de l’écorce terrestre. De tels mouvements s’accompagnent d’explosions de toutes sortes. La guerre en Ukraine – où se prépare une défaite humiliante pour les Etats-Unis et l’OTAN – et le conflit au Moyen-Orient en sont l’expression.
L’approche de Trump en matière de relations mondiales représente une tentative de reconnaître que les Etats-Unis ne peuvent pas être le seul gendarme du monde. De son point de vue, et de celui de ses proches collaborateurs, la tentative des Etats-Unis de maintenir leur hégémonie et leur domination totale est extrêmement coûteuse, peu efficace et préjudiciable à leurs intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale.
Cela ne signifie pas que les Etats-Unis cessent d’être une puissance impérialiste ou que les politiques de Trump sont dans l’intérêt des peuples opprimés du monde. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La politique étrangère de Trump représente une délimitation nette de ce que sont et de ce que ne sont pas les intérêts fondamentaux des Etats-Unis en matière de sécurité nationale, en commençant par l’Amérique du Nord.
Lorsque Trump dit que l’Amérique a besoin de contrôler le canal de Panama et le Groenland, il exprime les besoins de l’impérialisme américain. Le canal de Panama est une route commerciale cruciale, reliant le Pacifique au golfe du Mexique et transportant 40 % du trafic de conteneurs des Etats-Unis.
Quant au Groenland, il a toujours eu une position géostratégique importante, ce qui explique la présence militaire américaine sur l’île. Le réchauffement climatique a entraîné une augmentation du trafic maritime entre le Pacifique et l’Atlantique à travers l’Arctique. La fonte de la banquise facilite l’accès aux fonds marins, où se trouvent d’énormes réserves de minéraux de terres rares. L’île elle-même possède également d’importants gisements de minéraux stratégiques (terres rares, uranium) ainsi que de gaz et de pétrole, qui deviennent aujourd’hui plus accessibles, là encore du fait du réchauffement climatique. Les Etats-Unis sont en concurrence avec la Chine et la Russie pour le contrôle de ces routes commerciales et de ces ressources.
La politique étrangère de Trump est fondée sur la reconnaissance des limites de la puissance américaine. Il s’agit donc d’une tentative de dégager l’Amérique d’une série de conflits coûteux (Ukraine, Moyen-Orient) par le biais d’accords, afin de reconstruire sa puissance et de se concentrer sur son principal rival sur la scène mondiale, la Chine.
Pendant toute la période qui s’est écoulée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être même avant, l’impérialisme américain a prétendu agir au nom des droits de l’homme, de la diffusion de la démocratie et de l’« ordre fondé sur le Droit », de la défense du « principe sacré de l’inviolabilité des frontières nationales », et ainsi de suite.
Ils agissaient par le biais d’institutions internationales « multilatérales », qui se présentaient comme neutres, dans lesquelles tous les pays avaient leur mot à dire : les Nations unies, l’OMC, le FMI, etc. En réalité, ce n’était qu’une mascarade. Soit ces institutions exprimaient les intérêts de l’impérialisme américain, soit celui-ci les ignorait complètement. La différence aujourd’hui, c’est que Trump ne se soucie absolument pas de ces faux-semblants. Il semble déterminé à déchirer l’ensemble des règles et à exprimer les choses plus ouvertement, telles qu’elles sont réellement.
Certains ont affirmé que, face à la puissance débridée des Etats-Unis, l’idée d’un monde multipolaire était quelque chose de progressiste, qui permettrait aux pays opprimés de jouir d’un plus grand degré de souveraineté, un idéal pour lequel nous devrions nous battre. Aujourd’hui, nous avons un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un monde « multipolaire » : des puissances impérialistes découpant le monde en sphères d’influence, intimidant les pays pour qu’ils se soumettent à l’une ou à l’autre.
Le déclin relatif de l’impérialisme américain
Nous devons souligner que lorsque nous parlons du déclin de l’impérialisme américain, nous entendons par là un déclin relatif. C’est-à-dire un déclin par rapport à la position qu’il occupait auparavant vis-à-vis d’autres puissances concurrentes. Les Etats-Unis restent, à tous points de vue, la force la plus puissante et la plus réactionnaire du monde.
En 1985, les Etats-Unis représentaient 36 % du PIB mondial. Ils n’en représentent plus que 26 % (en 2024). Au cours de la même période, la Chine est passée de 2,5 % du PIB mondial à 18,5 %. Le Japon, qui a atteint un sommet de 18 % en 1995, n’en représente plus que 5,2 %.
Les Etats-Unis dominent toujours l’économie mondiale grâce à leur contrôle des marchés financiers. 58 % des réserves monétaires mondiales sont détenues en dollars américains (contre seulement 2 % en renminbi chinois), bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à 2001 (73 %). Le dollar représente également 58 % de la facturation des exportations mondiales. En termes de sorties nettes d’investissements directs étrangers (une approximation de l’exportation de capitaux), les Etats-Unis occupent la première place avec 454 000 milliards de dollars, tandis que la Chine (y compris Hong Kong) arrive en deuxième position avec 287 000 milliards de dollars.
C’est la puissance économique d’un pays qui lui confère son poids international, mais elle doit être soutenue par une puissance militaire. Les dépenses militaires des Etats-Unis représentent 40 % du total mondial, la Chine venant en deuxième position avec 12 % et la Russie en troisième avec 4,5 %. Dans le classement mondial des dépenses militaires, les Etats-Unis dépensent plus que les dix pays suivants réunis.
Néanmoins, les Etats-Unis ne peuvent plus prétendre être le maître incontesté du monde. La puissance économique colossale de la Chine et son développement militaire conséquent, ainsi que la supériorité militaire dont la Russie a fait la preuve sur les champs de bataille d’Ukraine, représentent pour eux un formidable défi. Les limites de la puissance mondiale de l’Amérique sont cruellement mises à nu de toutes parts.
Ce déclin relatif s’exprime économiquement par une fuite partielle des capitaux au détriment du dollar, des bons du Trésor américain et des actions américaines. Les monopoles américains étant confrontés à une concurrence internationale croissante, notamment de la part de la Chine, les actions américaines ne sont plus considérées comme une valeur sûre par les investisseurs. De même, alors que la montagne de la dette fédérale américaine s’alourdit et que le gouvernement américain a recours à un déficit financier de plus en plus important, les bons du Trésor américain (obligations de la dette publique) ne sont plus considérés comme la valeur refuge financière qu’ils étaient auparavant. Cela a conduit à un affaiblissement du dollar – en dépit des tarifs douaniers américains – et de sa domination dans l’arène financière mondiale.
Il s’agit d’une « correction du marché », qui rapproche le prix de la monnaie, des actifs et des obligations des Etats-Unis de la position économique réelle, plus faible, du capitalisme américain. Néanmoins, à l’instar de la puissance militaire américaine et de l’ancien rôle de l’Amérique en tant que gendarme du monde, il n’existe pas d’alternative viable au dollar en matière de commerce et de finance mondiaux. D’où l’inquiétude croissante des stratèges bourgeois quant au chaos que provoque dans le système financier et l’économie d’un effondrement de la confiance dans le dollar.
C’est une autre façon dont le déclin relatif du capitalisme américain et la « multipolarité » émergente contribueront à accroître l’incertitude et l’instabilité à l’échelle mondiale. L’un après l’autre, tous les piliers de l’ordre d’après-guerre sont érodés et sapés, avec des conséquences explosives sur les plans économique, militaire et politique.
Le poids militaire de la Russie
Si la Russie n’est pas un colosse économique comparable à la Chine, elle s’est dotée d’une base économique et technologique solide. Cela lui a permis de résister avec succès à l’agression économique sans précédent que l’Occident lui a infligée à travers les « sanctions ». De plus, elle a fait cela tout en menant une guerre qui a mis en échec tous les systèmes d’armes que l’impérialisme occidental a jeté contre elle. La Russie a construit une armée puissante qui n’a rien à envier aux forces combinées des Etats européens ; elle a mis sur pied une formidable industrie de la défense qui surpasse les Etats-Unis et l’Europe en matière de chars, d’artillerie, de munitions, de missiles et de drones ; et elle possède le plus grand arsenal nucléaire du monde, hérité de l’URSS.

Après l’effondrement de l’Union soviétique et le pillage complet de l’économie planifiée, la classe dirigeante russe a caressé l’idée d’être acceptée à la table mondiale sur un pied d’égalité. Elle a même avancé l’idée d’adhérer à l’OTAN. Cette idée a été rejetée. Les Etats-Unis voulaient exercer une domination totale et sans entrave sur le monde et ne voyaient pas la nécessité de partager le pouvoir avec une Russie faible et en crise.
L’humiliation de la Russie a été révélée de manière flagrante, tout d’abord lorsque l’Allemagne et les Etats-Unis ont organisé le dépeçage réactionnaire de la Yougoslavie, qui appartenait à la sphère d’influence traditionnelle de la Russie, puis avec le bombardement de la Serbie en 1999. Eltsine, un bouffon ivrogne et une marionnette de l’impérialisme américain, était l’incarnation de cette subordination.
Cependant, alors que la Russie se remettait progressivement de la crise économique, ses cercles dirigeants n’étaient plus disposés à accepter leur humiliation sur la scène internationale. C’est ce qui a servi de base à l’ascension de Poutine, un bonapartiste rusé qui s’est frayé un chemin vers le pouvoir par toutes sortes de manœuvres.
Les Russes ont commencé à s’opposer à l’expansion de l’OTAN vers l’Est, qui rompait toutes les promesses faites aux Russes en 1990. Les Occidentaux leur avaient alors promis que l’OTAN ne s’étendrait pas en Europe orientale, si les Russes acceptaient l’intégration de l’Allemagne réunifiée au sein de l’Alliance atlantique.
En 2008, la Russie a mené une guerre courte et efficace en Géorgie, détruisant l’armée géorgienne, qui avait été entraînée et équipée par l’OTAN. Ce fut le premier coup de semonce signalant que la Russie n’accepterait plus les empiétements de l’Occident. La Syrie et l’Ukraine ont suivi. Dans chacun de ces pays, la force de la Russie par rapport à l’impérialisme américain a été mise à l’épreuve. Le déclin relatif de l’impérialisme américain, quant à lui, a été révélé par leur retrait humiliant d’Afghanistan en août 2021.
L’invasion russe de l’Ukraine était la conclusion logique du refus de l’Occident de prendre en compte les préoccupations de la Russie en matière de sécurité nationale, exprimées par l’exigence de la neutralité de l’Ukraine et de la fin de l’expansion de l’OTAN vers l’Est. Lorsque Donald Trump affirme que cette guerre n’était pas nécessaire et que s’il avait été président, elle n’aurait jamais eu lieu, c’est probablement vrai. L’impérialisme américain et ses alliés européens savaient pertinemment que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constituait une ligne rouge du point de vue des intérêts de la Russie en matière de sécurité nationale. Malgré cela, ils ont décidé d’inviter les Ukrainiens à poser leur candidature à l’adhésion à l’OTAN en 2008. Il s’agissait d’une flagrante provocation, qui devait logiquement avoir de graves conséquences. C’est cette étape fatale qui a finalement conduit à la guerre.
L’Occident a insisté sur le « droit de l’Ukraine à adhérer à l’OTAN », alors que son statut de neutralité, l’interdiction des bases militaires étrangères et la non-participation à des blocs militaires avaient été négociés et étaient même inscrits dans la déclaration d’indépendance de l’Ukraine. Le directeur de la CIA, William J. Burns, avait à plusieurs reprises mis en garde contre les conséquences potentielles de cette politique. Mais la clique de bellicistes qui dirigeait la politique étrangère de l’administration Biden – et Joe Biden lui-même – avait d’autres idées.
Biden pensait pouvoir utiliser l’Ukraine comme chair à canon dans une campagne visant à affaiblir la Russie et à paralyser son intervention dans les affaires mondiales. Un rival de l’impérialisme américain comme la Russie ne pouvait être autorisé à menacer l’hégémonie mondiale des Etats-Unis. En mars 2022, Biden, gonflé par sa propre arrogance, a même évoqué l’idée d’un changement de régime à Moscou ! Avec les Européens, il était convaincu que les sanctions économiques et l’épuisement militaire conduiraient à l’effondrement de la Russie. Ils ont gravement sous-estimé l’étendue de la puissance économique et militaire de la Russie. En conséquence, l’impérialisme américain s’est retrouvé embarqué dans une guerre ingagnable, qui a représenté une ponction colossale sur ses ressources financières et militaires.
Trump insiste aujourd’hui sur le fait que ce désastre n’est pas de son fait. Il déclare : « Ce n’est pas ma guerre. C’est la guerre de Joe Biden ». Et c’est exact. Les stratèges du capital sont tout à fait capables de commettre des erreurs basées sur des calculs erronés. En voici un exemple. Lorsque Trump affirme que la guerre en Ukraine ne représente pas les « intérêts fondamentaux » de l’Amérique, il a tout à fait raison. L’Amérique est confrontée à une menace bien plus importante en Asie et dans le Pacifique, avec la montée en puissance de la Chine, en plus d’autres problèmes au Moyen-Orient et d’une crise économique croissante. C’est ce qui explique sa hâte à essayer d’extirper l’impérialisme américain du bourbier ukrainien. Mais les problèmes créés par Biden et ses larbins européens s’avèrent difficiles à résoudre.
Les hommes et les femmes qui gouvernent à Washington, Londres, Paris et Berlin ont systématiquement saboté toute tentative de solution pacifique. En avril 2022, les négociations en Turquie entre l’Ukraine et la Russie étaient assez avancées et auraient pu conduire à la fin de la guerre, sur la base de l’acceptation d’un certain nombre d’exigences russes. L’impérialisme occidental, en la personne de Boris Johnson, a fait échouer les négociations, en faisant pression sur Zelensky pour qu’il ne signe pas, en lui promettant en échange un soutien illimité jusqu’à la victoire totale de l’Ukraine.
Aujourd’hui, les Etats-Unis sont confrontés à une défaite humiliante en Ukraine. Les sanctions n’ont pas eu l’effet escompté. Au lieu de s’effondrer, l’économie russe a bénéficié de taux de croissance dépassant de loin ceux de l’Occident. Loin de s’isoler, elle a établi des liens économiques plus étroits avec la Chine et un certain nombre de pays clés qui sont censés faire partie de la sphère d’influence des Etats-Unis. Des pays comme l’Inde, l’Arabie saoudite, la Turquie et d’autres l’ont aidé à contourner les sanctions.
La Chine et la Russie sont devenues des alliés beaucoup plus proches, unis par leur opposition à la domination américaine sur le monde, et ont rassemblé autour d’elles toute une série d’autres pays. Lorsque la défaite américaine en Ukraine sera enfin actée, elle aura des conséquences énormes et durables sur les relations mondiales, affaiblissant encore davantage le pouvoir de l’impérialisme américain à travers le monde.
La défaite des Etats-Unis et de l’OTAN en Ukraine sera un message clair. La plus grande puissance impérialiste du monde ne peut pas toujours imposer sa volonté. En outre, la Russie dispose maintenant d’une immense armée, éprouvée dans les plus récentes méthodes et techniques de la guerre moderne, et d’un puissant complexe militaro-industriel.
La politique de Trump représente ici un tournant brutal par rapport à la politique précédente de l’impérialisme américain. Il a reconnu que cette guerre contre la Russie ne peut être gagnée et tente donc d’en extraire les Etats-Unis. Il estime également que la conclusion d’un accord avec la Russie reconnaissant ses intérêts en matière de sécurité nationale (c’est-à-dire ceux de l’impérialisme russe) pourrait l’éloigner de son allié chinois, qui est le principal rival de l’impérialisme américain sur la scène mondiale. Toutefois, il est peu probable que ces manœuvres portent leurs fruits, étant donné qu’au cours des trois années de guerre, l’Occident a poussé la Russie trop près de la Chine pour qu’elle puisse facilement revenir sur ce processus. Les récentes déclarations et actions des gouvernements russe et chinois indiquent au contraire que les deux parties considèrent leur rapprochement comme ayant une importance stratégique.
La montée de la Chine en tant que puissance impérialiste
La transformation rapide de la Chine, qui est passée d’une extrême arriération économique à un puissant pays capitaliste, a peu d’équivalents dans l’histoire moderne. En un laps de temps étonnamment court, elle s’est hissée à une position qui lui permet de défier la puissance de l’impérialisme américain.
La Chine d’aujourd’hui n’a absolument rien à voir avec la nation semi-féodale et semi-coloniale, faible et dominée, qu’elle était en 1938. En fait, à l’heure actuelle, la Chine n’est pas seulement un pays capitaliste, mais présente toutes les caractéristiques d’une puissance impérialiste à part entière.

Il est impossible d’expliquer cette transformation sans comprendre le rôle crucial joué par la révolution chinoise de 1949, qui a aboli la propriété foncière et le capitalisme et a jeté les bases d’une économie planifiée et nationalisée, condition préalable à la transformation de la Chine d’une nation arriérée et semi-coloniale à sa position actuelle de géant économique.
Arrivée tardivement sur la scène internationale, elle a dû se battre pour contrôler les sources de matières premières et d’énergie de son industrie, les champs d’investissement pour ses capitaux, les routes commerciales pour ses importations et ses exportations, et les marchés pour ses produits. Dans tous ces domaines, elle a remporté des succès notables.
L’essor de la Chine, qui dure depuis 30 ans, est le résultat d’investissements massifs dans les moyens de production et de sa dépendance à l’égard des marchés mondiaux. Dans un premier temps, elle a tiré parti de ses importantes réserves de main-d’œuvre bon marché pour exporter des produits tels que des textiles et des jouets sur le marché mondial.
Aujourd’hui, c’est une économie capitaliste technologiquement avancée, qui occupe une position dominante au niveau mondial sur une série de marchés de haute technologie (véhicules électriques et batteries, cellules photovoltaïques, antibiotiques, drones commerciaux, infrastructure de communications cellulaires 5G, centrales nucléaires, etc.
La Chine est également un leader mondial dans le domaine de la robotique. Elle se classe au troisième rang mondial pour la densité de robots industriels, avec 470 pour 10 000 travailleurs du secteur manufacturier, alors que sa main-d’œuvre manufacturière s’élève à plus de 37 millions de personnes. Elle se place ainsi derrière la Corée du Sud (1012) et Singapour (770), devant l’Allemagne (429) et le Japon (419), tout en étant bien au-dessus du niveau des Etats-Unis (295). Il s’agit de chiffres pour 2023, et le classement de la Chine s’est probablement amélioré depuis, puisqu’en 2023, elle représentait 51 % de toutes les nouvelles installations de robots industriels dans le monde.
En termes d’exportation de capitaux, la Chine est devancée par les Etats-Unis. En 2023, les Etats-Unis représentaient 32,8 % des sorties mondiales d’investissements directs étrangers, la Chine et Hong Kong représentant à eux deux 20,1 %. En termes de stock d’IDE accumulé, les Etats-Unis représentaient 15,1 % du total mondial, contre 11,3 % pour la Chine et Hong Kong.
En raison de la façon dont le capitalisme a été restauré en Chine, l’Etat joue un rôle important dans l’économie. Il a mené une politique délibérée visant à encourager et à financer le développement de la technologie. Le programme « Made in China 2025 » avait pour objectif de réaliser un grand bond en avant dans les industries clés et de rendre le pays autosuffisant et non dépendant de l’Occident. Les dépenses de la Chine en matière de recherche et de développement ont considérablement augmenté et sont presque équivalentes à celles des Etats-Unis.
Ce succès n’a pas été obtenu sans créer des contradictions et des conflits croissants avec d’autres nations capitalistes, ce qui a conduit à la guerre commerciale actuelle avec les Etats-Unis.
Après l’effondrement de l’Union soviétique et l’ouverture de nouveaux marchés dans le cadre de la politique de mondialisation, la croissance de l’économie capitaliste en Chine a d’abord été considérée par les économistes et les investisseurs occidentaux comme une occasion en or.
Les investisseurs occidentaux se sont empressés d’installer des usines en Chine, où ils pouvaient exploiter une main-d’œuvre apparemment inépuisable et bon marché. Entre 1997 et 2019, 36 % de la croissance mondiale du stock de capital s’est produite en Chine. La pénétration de la Chine par les capitaux américains était telle que les deux économies semblaient indissolublement liées.
La croissance chinoise a en effet joué un rôle crucial dans le développement de l’économie mondiale pendant plusieurs décennies. En 2008, les bourgeois occidentaux ont même espéré que la Chine contribuerait à sortir l’économie mondiale de la récession. Toutefois, comme nous l’avons souligné à l’époque, cette dynamique comportait un revers très grave et menaçant pour eux.
Ces usines, utilisant des technologies modernes, allaient inévitablement finir par produire de grandes quantités de marchandises bon marché qui devraient être exportées, puisque la demande en Chine elle-même restait limitée. En fin de compte, cela a causé de graves problèmes aux Etats-Unis et à d’autres économies occidentales.
Tout s’est transformé en son contraire. La question se pose de plus en plus : qui aide qui ? Il est vrai que les investisseurs occidentaux réalisaient de gros bénéfices, mais la Chine mettait en place des capacités de production avancées, une expertise technologique, des infrastructures et une main-d’œuvre qualifiée. Cette situation est de plus en plus perçue comme une menace, en particulier aux Etats-Unis.
La Chine est aujourd’hui devenue un fournisseur irremplaçable pour les fabricants mondiaux, qu’il s’agisse de produits de consommation finis comme les iPhones ou de biens d’équipement et de composants essentiels. La Chine est le principal fournisseur de 36 % des importations américaines, répondant à plus de 70 % de la demande américaine pour ces produits.
La Chine est devenue un rival systémique des Etats-Unis sur la scène mondiale. Telle est la véritable signification de la guerre commerciale menée par Trump contre ce pays. Il s’agit d’une lutte entre deux puissances impérialistes pour affirmer leur force relative sur le marché mondial.
Washington a eu recours aux mesures les plus extrêmes pour y parvenir, en interdisant la vente des puces les plus avancées à la Chine, en interdisant la vente des machines de lithographie les plus perfectionnées, et en empêchant des entreprises comme Huawei de candidater pour des contrats d’infrastructure 5G dans plusieurs pays, etc.
Mais les tentatives des Etats-Unis de bloquer le développement de la Chine dans les technologies de pointe ont eu l’effet inverse. En réponse, la Chine a accéléré ses efforts pour parvenir à l’autosuffisance. Bien qu’elle soit toujours confrontée à des goulets d’étranglement, par exemple parce qu’elle n’a pas accès aux machines de lithographie EUV les plus modernes, qui sont utilisées pour fabriquer les microprocesseurs les plus perfectionnés, la Chine a fait preuve d’ingéniosité pour trouver des solutions et contourner partiellement ces blocages.
Il est vrai que, malgré ses progrès, de nombreuses contradictions existent dans l’économie chinoise. La productivité du travail en Chine a augmenté grâce au développement de la science, de l’industrie et de la technologie, alors qu’en Europe, elle a stagné pendant une longue période et qu’aux Etats-Unis, elle n’a connu ces dernières années qu’une croissance modeste. Pourtant, la productivité globale de la main-d’œuvre chinoise reste largement inférieure à celle des Etats-Unis. Il faudra du temps pour combler cet écart.
On peut également supposer que les taux de croissance sans précédent que la Chine a connu au cours des dernières décennies ne seront pas maintenus. En fait, le ralentissement a déjà commencé. Dans les années 1990, la Chine a connu un rythme de croissance époustouflant de 9 % par an, avec des pointes à 14 %. Entre 2012 et 2019, sa croissance s’est située entre 6 et 7 %. Aujourd’hui, elle se situe autour de 5 %. Il n’en reste pas moins que l’économie chinoise dans son ensemble continue de croître plus rapidement que les pays capitalistes avancés de l’Occident.
Du fait même qu’elle est devenue une économie capitaliste et fortement intégrée au marché mondial, la Chine est confrontée à tous les problèmes que cela implique. Il existe déjà des disparités régionales en matière de développement économique, ainsi que des inégalités massives de revenus. Le chômage a augmenté parmi les travailleurs migrants et les jeunes.
Les vastes plans de relance économique, les mesures keynésiennes, ont entraîné une augmentation de la dette. La dette publique par rapport au PIB, qui n’était que de 23 % en 2000, est passée à 60,5 % en 2024. Il s’agit d’une augmentation significative, mais qui reste inférieure à celle de la plupart des économies capitalistes avancées. La dette totale (Etat, entreprises et ménages) a toutefois atteint 300 % du PIB.
La montée du protectionnisme et le ralentissement du commerce mondial affecteront sans aucun doute la Chine. La seule façon pour elle de surmonter cette crise sera de pousser plus fort pour écouler sa surproduction sur le marché mondial, ce qui aura pour effet d’accroître les tensions à l’échelle mondiale et d’aggraver la crise du système dans son ensemble.
Dans cette lutte titanesque entre deux géants économiques, la question est posée sans détour : qui l’emportera ? Les colonnes de la presse occidentale regorgent d’appréciations négatives et d’avertissements sinistres sur l’avenir de l’économie chinoise.
La presse occidentale s’efforce constamment de présenter une image très noire de l’économie chinoise – comme elle le fait invariablement pour l’économie russe, qui maintient pourtant un taux de croissance sain d’environ 4 à 5 % par an. Cela ne laisse pas correspond pas à une économie au bord de l’effondrement.
La Chine n’est certes pas à l’abri d’une crise, mais elle dispose de réserves considérables pour relever ce défi et s’en sortir avec beaucoup moins de dégâts que ce qui est souvent annoncé dans la presse occidentale. Surtout, il faut garder à l’esprit que la Chine, bien qu’étant un pays capitaliste, présente encore de nombreuses particularités.
Son économie conserve encore des éléments considérables de contrôle, d’intervention et de planification de la part de l’Etat. Cela joue en sa faveur, par rapport à des pays comme les Etats-Unis.
Il existe également des facteurs politiques, culturels et psychologiques importants qui peuvent jouer un rôle décisif dans tout conflit avec des puissances impérialistes étrangères. Le peuple chinois garde un souvenir vivace et amer de sa longue histoire de soumission, d’exploitation et d’humiliation par l’impérialisme.
Quelle que soit l’aversion que le peuple chinois éprouve pour sa propre classe dirigeante, sa haine des impérialistes étrangers est bien plus profonde et cela peut fournir au régime un soutien puissant dans sa lutte contre les Etats-Unis.
Les cercles dirigeants des Etats-Unis ont observé la montée en puissance de la Chine avec une panique croissante. Ils ont adopté une attitude belliqueuse, exprimée, d’une part, par les scandaleuses hausses de tarifs douaniers de Trump et, d’autre part, par de constantes provocations au sujet de Taïwan.
Les bellicistes de Washington accusent constamment la Chine de vouloir envahir ce que les Chinois considèrent comme une île rebelle qui leur revient de droit.
Mais les cercles dirigeants chinois sont dirigés par des hommes qui ont appris depuis longtemps l’art de la patience en diplomatie. Ils n’ont pas besoin d’envahir Taïwan. Ils savent que, tôt ou tard, l’île sera réunie au continent. Ils ont attendu des décennies pour reprendre le contrôle de Hong Kong aux Britanniques. Et ils ne voient aucune raison de chercher une solution militaire hâtive au problème.
Seule une grave erreur de calcul de la part des bellicistes de Washington, ou une décision irréfléchie des nationalistes taïwanais de proclamer l’indépendance, les pousserait à agir militairement. Dans de telles circonstances, les hommes de Pékin auraient toutes les cartes en main.

Il est impossible que Taïwan puisse résister longtemps à la puissance de l’armée et de la marine chinoises, qui ne sont stationnées qu’à quelques kilomètres, alors que les Américains devraient déplacer une force importante pour faire face à des conditions difficiles et dangereuses de l’autre côté d’un océan.
En tout état de cause, rien n’indique que Donald Trump lui-même recherche un conflit militaire avec la Chine. Il préfère d’autres méthodes – l’imposition de sanctions paralysantes et de droits de douane élevés, pour forcer la Chine à se soumettre. Mais la Chine n’a pas l’intention de se soumettre, que ce soit dans le cadre d’une guerre économique ou d’un véritable conflit militaire.
Jusqu’à récemment, la Chine a projeté sa puissance sur la scène internationale principalement par des moyens économiques, mais elle est également en train de renforcer sa puissance militaire. Elle a récemment annoncé une augmentation de 7,2 % de ses dépenses de défense. Elle possède déjà une armée de terre énorme et puissante et est en train de développer une marine tout aussi puissante et moderne pour défendre ses intérêts en haute mer.
Un article récent de la BBC indiquait qu’elle possède désormais la plus grande marine du monde, dépassant celle des Etats-Unis. Il n’est pas non plus exact de dire que ses forces armées sont basées sur des technologies et des équipements obsolètes. Le même article indiquait que :
« Selon le ministère américain de la défense, la Chine est désormais pleinement engagée dans le développement de la guerre « intelligentisée », c’est-à-dire des méthodes militaires futures basées sur des technologies perturbatrices, en particulier l’intelligence artificielle. »
Il ajoute que :
« L’Académie chinoise des sciences militaires a été chargée de s’assurer du succès de cette entreprise, par le biais d’une « fusion civilo-militaire », c’est-à-dire en associant les entreprises technologiques du secteur privé chinois aux industries de défense du pays. Des rapports suggèrent que la Chine pourrait déjà utiliser l’intelligence artificielle dans la robotique militaire et les systèmes de guidage de missiles, ainsi que dans les véhicules aériens sans pilote et les navires sans pilote ».
Par ailleurs, la Chine a l’un des programmes spatiaux les plus actifs au monde. Entre autres missions, elle a l’ambition de construire une station spatiale sur la lune et de mettre le pied sur Mars. Outre leur intérêt scientifique intrinsèque, ces projets sont clairement liés à un programme de réarmement très ambitieux.
Le développement des forces productives en Chine est désormais un fait établi. Il est inutile de le nier. Objectivement, il ne s’agit pas non plus d’un développement négatif du point de vue de la révolution mondiale, car cela a créé une classe ouvrière massive, habituée à une augmentation constante de son niveau de vie sur une longue période. Il s’agit d’une classe ouvrière jeune, fraîche, qui n’a pas connu de défaites et qui n’est pas liée à des organisations réformistes.
On affirme souvent que Napoléon aurait dit : « La Chine est un dragon endormi. Laissons-la dormir, car lorsqu’elle se réveillera, elle ébranlera le monde. » Qu’il ait dit cela ou non, cette phrase s’applique aujourd’hui sans aucun doute au puissant prolétariat chinois. Le moment de vérité peut être retardé pendant un certain temps. Mais lorsque cette force puissante commencera à bouger, elle provoquera une explosion aux proportions sismiques.
L’équilibre entre les puissances
Le déclin relatif de l’impérialisme américain et la montée en puissance de la Chine ont créé une situation dans laquelle certains pays peuvent profiter de l’équilibre entre les deux pour gagner un petit degré d’autonomie et poursuivre leurs propres intérêts, au moins au niveau régional. C’est le cas de pays comme la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Inde et d’autres encore à des degrés divers.
La montée en puissance des BRICS, qui ont été officiellement créés en 2009, représente une tentative de la Chine et de la Russie de renforcer leur position sur la scène mondiale, de protéger leurs intérêts économiques et d’intégrer toute une série de pays à leur sphère d’influence.
La mise en œuvre de sanctions économiques de grande envergure par l’impérialisme américain à l’encontre de la Russie a accéléré ce processus. En élaborant des mécanismes pour éviter et surmonter les sanctions, la Russie a conclu une série d’alliances avec d’autres pays, dont l’Arabie saoudite, l’Inde, la Chine et bien d’autres.
Alors qu’elles devaient être une démonstration de la puissance américaine, les sanctions ont échoué. Cela a mis à nu les limites de la capacité de l’impérialisme américain à imposer sa volonté et a poussé un certain nombre de pays à envisager des alternatives à la domination américaine sur les transactions financières. L’adhésion aux BRICS s’est élargie, de nouveaux pays ayant été invités ou ayant posé leur candidature.
Lorsque l’on aborde cette question, il est important de garder le sens des proportions. Aussi importants que soient ces changements, les BRICS sont criblés de toutes sortes de contradictions. Le Brésil, tout en faisant partie des BRICS, fait en même temps partie du Mercosur, le bloc de libre-échange sud-américain, qui négocie un accord de libre-échange avec l’UE.
L’Inde fait partie des BRICS, mais elle est réticente à l’idée d’accueillir de nouveaux membres, car cela diminuerait son poids au sein du bloc. Elle est également liée aux Etats-Unis par un « partenariat stratégique » ; elle fait partie de l’alliance militaire et de sécurité Quad avec les Etats-Unis, le Japon et l’Australie ; et sa marine effectue régulièrement des exercices militaires avec les Etats-Unis.
Ce qui est significatif ici, c’est qu’un pays comme l’Inde, allié des Etats-Unis et rival de la Chine, a joué un rôle important en aidant la Russie à contourner les sanctions américaines. L’Inde achète le pétrole russe à un prix réduit et le revend ensuite à l’Europe sous forme de produits raffinés à un prix plus élevé. Pour l’instant, les Etats-Unis ont décidé de ne pas prendre de mesures contre l’Inde.
Jusqu’à présent, les BRICS ne sont qu’une vague alliance de pays. Les pressions impérialistes des Etats-Unis à l’encontre de leurs rivaux les poussent à se rapprocher et encouragent d’autres pays à les rejoindre.
Crise en Europe
Alors que les Etats-Unis ont subi un déclin relatif de leur force et de leur influence au niveau mondial, les anciennes puissances impérialistes européennes – la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, etc. – ont encore reculé par rapport à leurs anciens jours de gloire et sont devenues des puissances mondiales de second ordre. Il convient de noter que l’Europe, en tant que bloc impérialiste, a été particulièrement affaiblie au cours de la dernière décennie. Une série de coups d’Etat militaires a, par exemple, évincé la France de l’Afrique centrale et du Sahel, en grande partie au profit de la Russie.
Les puissances européennes ont suivi l’impérialisme américain dans sa guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, ce qui a eu un impact dévastateur sur leur économie. Depuis l’effondrement du stalinisme en 1989-1991, l’Allemagne a poursuivi une politique d’expansion de son influence vers l’Est et a noué des liens économiques étroits avec la Russie. L’industrie allemande a bénéficié de l’énergie russe bon marché. Avant la guerre en Ukraine, plus de la moitié du gaz naturel, un tiers du pétrole et la moitié du charbon importés par l’Allemagne provenaient de Russie.
C’est l’une des raisons du succès de l’industrie allemande dans le monde, les deux autres étant la dérégulation du marché du travail (réalisée sous des gouvernements sociaux-démocrates) et les investissements injectés dans l’industrie dans la seconde moitié du siècle dernier. La domination de l’Union européenne par la classe dirigeante allemande et le libre-échange avec la Chine et les Etats-Unis ont complété un cercle vertueux qui a permis à l’Allemagne de sortir à première vue indemne de la crise de 2008.
La situation est similaire pour l’ensemble de l’UE, où la Russie est le premier fournisseur de pétrole (24,8 %), de gaz transporté par gazoduc (48 %) et de charbon (47,9 %). Les sanctions européennes imposées à la Russie après le début de la guerre en Ukraine ont entraîné une forte hausse des prix de l’énergie, avec un effet d’entraînement sur l’inflation et la perte de compétitivité des exportations européennes. En fin de compte, l’Europe a dû importer des Etats-Unis du gaz naturel liquéfié (GNL) beaucoup plus cher et payer beaucoup plus pour passer par l’Inde pour acheter des produits pétroliers russes.
En fait, une grande partie du gaz consommé en Allemagne provient toujours de Russie, mais il vient désormais sous forme de GNL, à un prix beaucoup plus élevé. Les classes dirigeantes allemande, française et italienne se sont tirées une balle dans le pied et en paient aujourd’hui le prix fort. Déjà sous la présidence Biden, les Etats-Unis ont remercié leurs alliés européens en menant contre eux une guerre commerciale par le biais d’une série de mesures protectionnistes et de subventions industrielles.
La Communauté économique européenne, et plus tard l’Union européenne, représentaient une tentative de la part des puissances impérialistes affaiblies du continent européen de se regrouper après la Seconde Guerre mondiale dans l’espoir d’avoir davantage de poids dans la politique et l’économie mondiales. Dans la pratique, le capital allemand a dominé les autres économies plus faibles. Tant que la croissance économique a été au rendez-vous, un certain degré d’intégration économique a été atteint et une monnaie unique a même été créée.
Cependant, les différentes classes dirigeantes nationales qui composaient l’Union ont continué d’exister, chacune avec ses propres intérêts. Malgré tous les discours, il n’y a pas de politique économique commune, pas de politique étrangère unifiée et pas d’armée unique pour la mettre en œuvre. Alors que le capital allemand était basé sur des exportations industrielles compétitives et que ses intérêts se trouvaient à l’Est, la France tire de l’UE des subventions agricoles considérables et ses intérêts impérialistes se trouvent dans ses anciennes colonies, principalement en Afrique.
La crise de la dette souveraine qui a suivi la récession de 2008 a poussé l’UE à ses limites. Depuis, la situation s’est encore aggravée. Le récent rapport de l’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, dépeint la crise du capitalisme européen en termes alarmants, mais il n’a pas tort. Au fond, la raison pour laquelle l’UE n’est pas en mesure de rivaliser avec ses rivaux impérialistes dans le monde est le fait qu’elle n’est pas une entité économique et politique unique, mais plutôt un ensemble de plusieurs petites et moyennes économies, chacune avec sa propre classe dirigeante, ses propres industries nationales, ses propres réglementations, etc. L’économie européenne est sclérosée et a été dépassée par ses concurrents en termes de croissance de la productivité.
Les forces productives ont dépassé l’Etat-nation, et ce problème est particulièrement aigu dans les économies européennes, petites mais très développées.
Le déclin prolongé des puissances impérialistes européennes a été masqué par le fait que les Etats-Unis assuraient leur défense et soutenaient l’UE sur le plan politique. Pendant près de 80 ans, l’impérialisme américain a soutenu l’Europe, sous sa domination, en tant que rempart contre l’Union soviétique. C’était un arrangement très utile pour le capitalisme européen, car il était en mesure d’externaliser une part importante du coût de sa défense militaire à son puissant cousin de l’autre côté de l’Atlantique.
C’est désormais fini. L’impérialisme américain sous l’égide de Trump a décidé de gérer son déclin relatif en tentant de s’entendre avec la Russie pour mieux se concentrer sur son principal rival sur l’échiquier mondial : La Chine. Le centre de la politique et de l’économie mondiales n’est plus l’Atlantique mais le Pacifique. Ce changement est en cours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il se manifeste aujourd’hui de manière explosive.
Il s’agit d’un bouleversement majeur pour les relations internationales, que personne ne peut ignorer. Si les Etats-Unis veulent s’entendre avec la Russie, l’impérialisme européen se retrouve en position de faiblesse. Les Etats-Unis ne sont plus son ami et son allié. Certains sont même allés jusqu’à dire que Washington considère désormais l’Europe comme un rival ou un ennemi.
À tout le moins, Trump a clairement indiqué que les Etats-Unis n’étaient plus disposés à subventionner la défense de l’Europe. Le retrait du parapluie protecteur des Etats-Unis, comme certains l’ont décrit, a révélé brutalement toutes les faiblesses accumulées de l’impérialisme européen, qui se sont accumulées au cours de décennies de déclin.
La crise du capitalisme européen a d’importantes implications politiques et sociales. La montée des forces populistes de droite, eurosceptiques et anti-establishment à travers le continent en est une conséquence directe. La classe ouvrière européenne, dont les forces sont largement intactes et invaincues, n’acceptera pas sans combattre une nouvelle vague de mesures d’austérité et de licenciements massifs. Le décor est planté pour une explosion de la lutte des classes.
La guerre au Moyen-Orient
Le conflit actuel au Moyen-Orient ne peut être compris que dans le contexte de la situation mondiale. L’impérialisme américain a été affaibli au Moyen-Orient, tandis que la Russie, la Chine et l’Iran se sont renforcés. Israël s’est senti menacé. L’attaque du 7 octobre a été un coup dur pour la classe dirigeante israélienne. Elle a détruit le mythe de l’invincibilité et remis en cause la capacité de l’Etat sioniste à protéger ses citoyens juifs, question clé utilisée par la classe dirigeante israélienne pour rassembler la population derrière elle.
Elle a également mis en évidence l’effondrement des accords d’Oslo, signés au lendemain de l’effondrement du stalinisme. Ces accords n’étaient qu’une cynique mascarade. La classe dirigeante sioniste n’a jamais vraiment envisagé de concéder aux Palestiniens une patrie viable. Elle considérait l’Autorité nationale palestinienne (AP) comme un simple moyen d’externaliser le maintien de l’ordre chez les Palestiniens. Le discrédit du Fatah et de l’AP – considérés à juste titre comme de simples marionnettes d’Israël – a conduit, avec l’approbation d’Israël, à la montée en puissance du Hamas, considéré par beaucoup de Palestiniens comme la seule force poursuivant la lutte pour leurs droits nationaux.
En réalité, les méthodes réactionnaires du Hamas ont conduit les Palestiniens dans une impasse dont il est difficile de voir l’issue.
Les accords d’Abraham, signés en 2020 sous la pression de la première administration Trump, étaient censés établir la position d’Israël en tant qu’acteur légitime dans la région et normaliser ses relations commerciales avec les pays arabes. Cela signifiait enterrer les aspirations nationales palestiniennes, ce que les régimes arabes réactionnaires n’ont pas hésité à faire. L’attaque du 7 octobre était une réponse désespérée à cette situation.
Elle a d’abord été accueillie avec jubilation par les Palestiniens, mais elle a eu des conséquences terribles. Alors que Netanyahou avait été confronté juste avant à un long mouvement de protestations de masse, cette attaque lui a donné une excuse parfaite pour lancer une campagne génocidaire contre Gaza. Un an plus tard, les Israéliens avaient réduit Gaza à un tas de décombres fumants, sans atteindre leurs objectifs déclarés : la libération des otages et la destruction du Hamas. Cela a conduit à des manifestations de masse de centaines de milliers d’Israéliens et même à une brève grève générale en septembre 2024.
Ces manifestations n’avaient pas pour caractère de soutenir la cause palestinienne, ni de s’opposer à la guerre en tant que telle. Néanmoins, le fait qu’il y ait eu une telle opposition de masse au premier ministre en pleine guerre est un signe de la profondeur des divisions au sein de la société israélienne.
L’effondrement de sa base de soutien a poussé Netanyahou à aggraver la situation avec l’invasion du Liban et l’attaque du Hezbollah, accompagnée de provocations constantes à l’égard de l’Iran. Il a plusieurs fois montré qu’il serait prêt pour sauver sa carrière politique à déclencher une guerre régionale, ce qui obligerait les Etats-Unis à intervenir directement à ses côtés.
Malgré le danger que le massacre de Gaza provoque une déstabilisation révolutionnaire des régimes arabes réactionnaires (en Arabie saoudite, en Egypte et surtout en Jordanie), Joe Biden a clairement indiqué que son soutien à Israël était « inébranlable », et Netanyahou a profité à plusieurs reprises de ce chèque en blanc, poursuivant sur la voie de l’escalade vers une guerre régionale. Outre le massacre génocidaire de Gaza, il a lancé une invasion terrestre du Liban, mené des frappes aériennes contre l’Iran, le Yémen et la Syrie, puis mis en œuvre une invasion terrestre de la Syrie.
L’effondrement soudain et inattendu du régime Assad en Syrie a une nouvelle fois modifié l’équilibre des forces régionales. La Turquie est une puissance capitaliste mineure en termes d’économie mondiale, mais elle a de grandes ambitions régionales. Erdogan a très habilement utilisé à son avantage le conflit entre l’impérialisme américain et la Russie.
Sentant que l’Iran et la Russie, avec lesquels il avait conclu un accord en Syrie en 2016, étaient engagés ailleurs (la Russie en Ukraine et l’Iran au Liban), Erdogan a décidé de soutenir l’offensive des djihadistes du HTS depuis Idlib. À la surprise générale, cela a précipité l’effondrement complet du régime. Les sanctions économiques, la corruption et le sectarisme l’avaient déjà vidé de sa substance bien plus que personne ne l’avait imaginé. Le dépeçage actuel de la Syrie est le prolongement de plus de 100 ans d’ingérence impérialiste, depuis les accords Sykes-Picot.
En fin de compte, il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient tant que la question nationale palestinienne n’est pas résolue. Mais cela n’est pas possible sous le capitalisme. Les intérêts de la classe dirigeante sioniste en Israël (soutenue par la puissance impérialiste la plus puissante du monde) ne permettent pas la création d’une véritable patrie pour les Palestiniens, et encore moins le droit au retour de millions de réfugiés.
D’un point de vue purement militaire, les Palestiniens ne peuvent pas vaincre Israël, une puissance impérialiste moderne dotée de la technologie militaire la plus sophistiquée et d’un service de renseignement sans égal, qui est de plus totalement soutenue par l’impérialisme américain.
Sur quelles autres forces les Palestiniens peuvent-ils donc compter ? Aucune confiance ne peut être accordée aux régimes arabes réactionnaires, qui soutiennent la cause palestinienne du bout des lèvres, mais qui l’ont trahie et ont collaboré avec Israël et l’impérialisme à chaque étape.
Les seuls vrais amis des Palestiniens se trouvent dans les rues arabes – les masses opprimées des ouvriers, des paysans, des petits commerçants et des pauvres des villes et des campagnes. Mais leur tâche immédiate est de régler leurs comptes avec leurs propres dirigeants réactionnaires. Cela pose la question de l’abolition du capitalisme par l’expropriation des propriétaires terriens, des banquiers et des capitalistes. Sans cela, la révolution en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ne pourra jamais aboutir.
Une classe ouvrière puissante existe dans la région, surtout en Egypte et en Turquie, mais aussi en Arabie Saoudite, dans les Etats du Golfe et en Jordanie. Un soulèvement réussi dans l’un de ces pays, amenant la classe ouvrière au pouvoir, modifierait l’équilibre des forces. Il créerait ainsi des conditions plus favorables à la libération des Palestiniens et préparerait la voie à une guerre révolutionnaire contre Israël, qui découlerait inévitablement de l’ensemble de cette nouvelle situation.
L’Etat d’Israël et sa classe dirigeante sioniste ne peuvent être vaincus qu’en divisant la population israélienne selon des lignes de classe. Pour l’instant, la perspective d’une division de classe en Israël semble lointaine. Cependant, la guerre et les conflits constants peuvent finalement amener une partie des masses israéliennes à tirer la conclusion que la seule voie vers la paix passe par une solution juste de la question nationale palestinienne.
Sans une perspective de transformation socialiste révolutionnaire de la société, des guerres sans fin, menées par des gouvernements réactionnaires avec des puissances impérialistes qui tirent les ficelles, ne résoudront rien. Sous la domination de l’impérialisme, les cessez-le-feu temporaires et les accords de paix ne feront que préparer le terrain pour de nouvelles guerres. Mais l’instabilité générale qui est à la fois la cause des guerres et leur conséquence créera les conditions d’un mouvement révolutionnaire des masses dans la prochaine période.
La révolution palestinienne ne pourra triompher qu’en tant que révolution socialiste et dans le cadre d’un soulèvement général de la masse des travailleurs et des paysans pauvres contre les régimes réactionnaires de la région. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord possèdent des ressources colossales inexploitées qui pourraient servir à construire une société florissante et prospère. Au lieu de cela, toute l’histoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord depuis les soi-disant indépendances de la domination impérialiste directe n’a été qu’un cauchemar pour la majorité de la population. La bourgeoisie s’est montrée incapable de résoudre ses problèmes fondamentaux.
Un rôle particulièrement nuisible a été joué par les staliniens qui se sont basés sur la fausse théorie des « deux étapes », qui sépare artificiellement la révolution prolétarienne de la soi-disant révolution démocratique bourgeoise. Cette théorie réactionnaire a conduit à une défaite désastreuse après l’autre, et a créé les conditions pour l’instauration d’un régime dictatorial réactionnaire et pour la croissance de la folie du fondamentalisme religieux dans un pays après l’autre. Seule une révolution socialiste victorieuse peut mettre fin à ce cauchemar.
Seule une fédération socialiste peut résoudre la question nationale une fois pour toutes. Tous les peuples, les Palestiniens et les Juifs israéliens, mais aussi les Kurdes, les Arméniens et tous les autres, auraient le droit de vivre en paix au sein d’une telle fédération socialiste. Le potentiel économique de la région serait pleinement exploité dans le cadre d’un plan de production socialiste commun. Le chômage et la pauvreté appartiendraient au passé. Ce n’est que sur cette base que les vieilles haines nationales et religieuses pourraient être surmontées et n’être plus que le souvenir d’un mauvais rêve.
C’est le seul véritable espoir pour les peuples du Moyen-Orient.
Course aux armements et militarisme
Historiquement, tout changement significatif dans la force relative des différentes puissances impérialistes a eu tendance à être réglé par la guerre, principalement les deux guerres mondiales du XXe siècle. Aujourd’hui, l’existence d’armes nucléaires exclut une guerre mondiale ouverte dans la période à venir.
Les capitalistes font la guerre pour contrôler des marchés, des champs d’investissement et des sphères d’influence. Une guerre mondiale aujourd’hui entraînerait la destruction à une échelle massive d’infrastructures et de vies humaines, ce dont aucune puissance ne profiterait. Pour qu’une guerre mondiale ait lieu, il faudrait qu’un dirigeant bonapartiste fou se retrouve à la tête d’une grande puissance nucléaire. Cela ne serait possible que sur la base de défaites décisives de la classe ouvrière. Telle n’est pas la perspective qui s’offre à nous.
Néanmoins, le conflit entre les puissances impérialistes, qui reflète la lutte pour un nouveau partage de la planète, domine la situation mondiale. Il se traduit par des guerres régionales, qui provoquent des destructions de grande ampleur et tuent des dizaines de milliers de personnes, ainsi que par des tensions commerciales et diplomatiques qui ne cessent de s’aggraver. L’année dernière, le nombre de guerres a été le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cela a entraîné une nouvelle course aux armements, la montée du militarisme dans les pays occidentaux et une pression accrue pour reconstruire, rééquiper et moderniser les forces armées partout dans le monde. Les Etats-Unis s’apprêtent à dépenser environ 1700 milliards de dollars sur 30 ans pour moderniser leur arsenal nucléaire. Ils viennent de décider de déployer des missiles de croisière sur le sol allemand pour la première fois depuis la fin de la guerre froide.
Une forte pression s’exerce sur tous les pays de l’OTAN pour qu’ils augmentent leurs dépenses de défense. La Chine a annoncé une augmentation de 7,2 % de ses dépenses de défense. À la suite de la guerre, les dépenses militaires de la Russie ont augmenté de 40 % en 2024, atteignant 32 % du budget fédéral et 6,68 % du PIB. En 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,44 billions de dollars, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à 2022. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 2009 et du niveau le plus élevé jamais enregistré.
Il s’agit là de sommes colossales, sans parler du gaspillage de la force de travail et du développement technologique, qui auraient pu être utilisés à des fins socialement utiles. C’est un point sur lequel les communistes doivent insister dans leur propagande et leur action.
Il serait simpliste de dire que les capitalistes se lancent dans une nouvelle course aux armements pour stimuler la croissance économique. En fait, les dépenses d’armement sont intrinsèquement inflationnistes. Tous leurs effets positifs sur l’économie seront de court terme et compensés par les politiques d’austérité appliquées dans d’autres secteurs. A long terme, ces dépenses constituent une ponction sur l’économie productive par le détournement de la plus-value. C’est bien le conflit entre les puissances impérialistes pour le partage du monde qui explique l’augmentation des dépenses militaires. Le capitalisme dans sa phase impérialiste conduit inévitablement à des conflits entre les puissances et, en fin de compte, à la guerre.
La lutte contre le militarisme et l’impérialisme est devenue un point central de notre époque. Nous sommes de fervents opposants aux guerres impérialistes et à l’impérialisme, mais nous ne sommes pas des pacifistes. Nous devons insister sur le fait que la seule façon de garantir la paix est d’abolir le système capitaliste qui engendre la guerre.
La course au réarmement du capitalisme européen
Dans le cas de l’Europe, la poussée vers le militarisme et les dépenses d’armement est le résultat du renforcement de l’impérialisme russe qui sort victorieux de la guerre en Ukraine, du retrait du soutien militaire des Etats-Unis et de la tentative des puissances européennes de montrer qu’elles jouent encore un rôle sur la scène mondiale.
Les dépenses militaires de la Russie pour 2024 s’élèvent à environ 13,1 billions de roubles (145,9 milliards de dollars), ce qui représente 6,68 % du PIB du pays. Cela représente une augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. Ajusté à la parité du pouvoir d’achat, ce chiffre s’élève à environ 462 milliards de dollars.
Dans le même temps, l’Europe a considérablement augmenté ses dépenses militaires de 50 % en termes nominaux depuis 2014, pour atteindre un total collectif de 457 milliards de dollars en 2024. Dans ce cas, il est logique d’ajuster le chiffre russe en fonction du pouvoir d’achat, puisque ce que nous comparons est la quantité de chars, de pièces d’artillerie ou de munitions que chaque dollar peut acheter, en Russie et en Europe. En d’autres termes, la Russie dépense plus dans le domaine militaire que l’ensemble de l’Europe.
La Russie produit également plus que l’ensemble de l’OTAN, y compris les Etats-Unis, en termes de munitions, de roquettes et de chars. Selon les estimations des services de renseignement de l’OTAN, la Russie produit 3 millions de munitions d’artillerie par an. L’ensemble de l’OTAN, y compris les Etats-Unis, ne peut en produire que 1,2 million, soit moins de la moitié du chiffre russe.
En outre, la guerre en Ukraine a complètement transformé la façon dont la guerre est menée. Comme toujours, la guerre permet de tester en conditions réelles de nouvelles technologies et techniques, qui sont rapidement adoptées et adaptées au champ de bataille. Les armées belligérantes sont obligées de développer rapidement des moyens et des tactiques pour les contrer. Nous avons vu l’introduction d’un grand nombre de drones (aériens, terrestres et maritimes), de techniques de surveillance électronique et de brouillage, etc.
Les seules armées à avoir une expérience concrète de ces nouvelles méthodes sont celles de l’Ukraine et de la Russie. L’Occident est très en retard dans tous ces domaines. La guerre en Ukraine a considérablement modifié l’équilibre des forces militaires en faveur de la Russie.
Cela ne signifie pas que la Russie ait intérêt à envahir l’Europe, ni même une partie de celle-ci. Cette soi-disant menace a été massivement exagérée par la classe dirigeante afin de justifier une forte augmentation des dépenses militaires et de réduire l’opposition de l’opinion publique. La Russie n’a aucun intérêt à envahir l’Ukraine occidentale – ce qui serait une entreprise bien plus coûteuse que l’actuelle campagne militaire russe – et encore moins à envahir les pays de l’OTAN.
Du point de vue du capitalisme européen, la menace n’est pas vraiment celle d’une invasion russe ou d’un conflit militaire ouvert entre les armées russes et européennes. Cela coûterait très cher aux deux parties. En outre, cela impliquerait que les deux camps en conflit soient dotées d’armes nucléaires, une situation très dangereuse.
La véritable menace pour l’impérialisme européen en crise est d’avoir été abandonné ou déclassé par la plus grande puissance impérialiste du monde, tout en étant voisin d’un autre impérialisme puissant, qui sort massivement renforcé de la guerre actuelle.
La Russie a beaucoup de poids (militairement et en termes de ressources énergétiques) et exerce déjà une forte influence sur la scène politique européenne. Des pays comme la Hongrie et la Slovaquie ont déjà rompu avec l’orientation atlantiste des puissances européennes dominantes. Dans d’autres, des forces politiques montantes vont dans le même sens à un degré ou à un autre (Allemagne, Autriche, Roumanie, République tchèque, Italie).
Ce que l’impérialisme européen défend, ce ne sont pas les vies et les foyers des peuples d’Europe, mais les profits de ses multinationales et les ambitions impérialistes prédatrices de ses classes dirigeantes capitalistes. La Russie est une rivale du capitalisme allemand en Europe centrale et orientale ainsi qu’une rivale de l’impérialisme français en Afrique.
La crise de longue durée du capitalisme européen signifie qu’une fois privée de la protection des Etats-Unis, l’Europe ne sera pas en mesure de se débrouiller seule. Elle est menacée d’être découpée entre les intérêts rivaux des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine. Les tendances centrifuges deviennent de plus en plus fortes, chaque classe capitaliste commençant à affirmer ses propres intérêts nationaux. Il n’est pas du tout exclu que ces tendances conduisent à terme à un éclatement de l’Union européenne.
L’économie mondiale : de la mondialisation aux guerres commerciales et au protectionnisme
L’introduction par Trump de tarifs douaniers de grande ampleur le 2 avril a marqué un tournant dans l’économie mondiale. Mais le processus de ralentissement de la mondialisation et le passage au protectionnisme avaient commencé plus tôt.
La récession mondiale de 2008 a marqué un tournant dans la crise capitaliste. Au cours de la période précédant immédiatement la crise, l’économie mondiale a connu une croissance d’environ 4 % par an. Entre la crise de 2008 et le choc de la pandémie de 2020, elle n’a progressé que de 3 %. Avant les droits de douane de Trump, la tendance était déjà aux alentours de 2 %, soit le taux de croissance le plus bas depuis trois décennies.
En fait, l’économie mondiale ne s’est jamais remise de la récession de 2008. À l’époque, les banques ont été massivement renflouées. Il s’agissait d’une mesure désespérée pour sauver le secteur financier. Les Etats européens ont accumulé des dettes et des déficits budgétaires massifs et ont été contraints de mettre en œuvre des mesures d’austérité. La classe ouvrière a dû payer le prix de la crise du capitalisme.
La classe dirigeante, prise de panique, a répondu par un programme massif d’assouplissement quantitatif, l’injection d’une grande quantité d’argent dans l’économie, et l’abaissement sans précédent des taux d’intérêt à zéro, voire même l’adoption de taux négatifs. Mais cela n’a pas permis de relancer l’économie, car les ménages étaient également endettés. Il n’y avait pas de champ d’investissement productif dans la production, de sorte que l’excès de liquidités a gonflé les bulles du prix des actions boursières, des crypto-monnaies, etc.
Les mesures d’austérité mises en œuvre par les gouvernements partout dans le monde ont conduit à des mouvements de masse dans le monde entier en 2011 : la révolution en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le mouvement Occupy aux Etats-Unis, le mouvement des « Indignados » en Espagne, le mouvement de la place Syntagma en Grèce, etc.
Cela reflétait un mécontentement croissant contre le système capitaliste qui faisait payer à la classe ouvrière les mesures de sauvetage des banques, ce qui a conduit au discrédit de toutes les institutions bourgeoises. Ce changement dans les consciences a – comme nous l’avons vu – trouvé une expression politique dans la montée d’un nouveau type de réformisme de gauche vers 2015 : Podemos, Syriza, Corbyn, Mélenchon, Sanders et les « gouvernements progressistes » d’Amérique latine.
Les masses ont été attirées par eux en raison de leur opposition apparemment radicale à l’austérité. Ce processus a pris fin lorsque les limites du réformisme sont devenues apparentes : avec la trahison du gouvernement Syriza en Grèce, le soutien de Sanders à Clinton, l’effondrement du Corbynisme et l’entrée de Podemos dans un gouvernement de coalition en Espagne.
Dans les pays dominés par l’impérialisme, nous avons assisté à des soulèvements et des insurrections de masse (à Porto Rico, en Haïti, en Equateur, au Chili, au Soudan, en Colombie, etc.). Les mobilisations de masse lors de la lutte pour une république en Catalogne en 2017 et 2019 s’inscrivaient également dans cette même tendance générale.
Le manque d’une direction a cependant fait qu’aucune d’entre elles n’a abouti au renversement du capitalisme, ce qui aurait été possible.
La pandémie de COVID-19 en 2020 a représenté un nouveau choc externe pour l’économie à un moment où elle se dirigeait déjà vers une nouvelle récession (elle ne s’était jamais complètement remise de la crise de 2008). Cela a finalement poussé l’économie mondiale au bord du gouffre.
Une fois de plus, prise de panique, la classe dirigeante a eu recours à des mesures désespérées pour éviter une explosion sociale. Dans les pays capitalistes avancés, les travailleurs ont été payés par l’Etat pour rester chez eux, ce qui a coûté très cher aux finances publiques, déjà criblées de dettes à la suite de la crise précédente.
Au cours des 15 dernières années, les tentatives répétées de relancer l’économie mondiale en injectant des quantités massives de liquidités dans le système par le biais de l’assouplissement quantitatif, de taux d’intérêt historiquement bas (2009-2021) et d’autres réactions de panique similaires ont échoué lamentablement à produire une croissance économique substantielle. Les capitalistes, bien que gavés d’argent, n’ont pas investi.
Le facteur déterminant est que les capitalistes ont besoin d’un marché où ils peuvent vendre leurs produits afin de réaliser des profits. L’accumulation massive de dettes signifie que les ménages et les entreprises sont incapables de stimuler la consommation.
La dette combinée des ménages, des Etats et des entreprises dans le monde a atteint environ 313 000 milliards de dollars, soit 330 % du PIB mondial, contre environ 210 000 milliards de dollars il y a dix ans.
La dette reflète le fait que les limites du système ont été poussées jusqu’à leur point de rupture et qu’elle constitue désormais un énorme obstacle à tout développement ultérieur. La combinaison de niveaux élevés de dette publique et de taux d’intérêt plus élevés a déjà fait s’effondrer une série de pays dominés. D’autres suivront.
La pandémie a également eu un impact sur les consciences, révélant l’incapacité du système capitaliste de profit privé à faire face à une situation d’urgence sanitaire, et la façon dont les géants de l’industrie pharmaceutique ont fait passer les profits avant les vies humaines.
Dans les années 1990 et 2000, l’économie mondiale a connu une certaine croissance, même si le taux de croissance était nettement inférieur à celui de la période d’expansion de l’après-guerre (1948-1973), qui avait été marquée par un développement important des forces productives. En outre, la croissance économique des années 1990 et 2000 était basée sur l’expansion du crédit et la « mondialisation ». Cela a permis au système de dépasser ses limites, partiellement et temporairement. La mondialisation signifiait l’expansion du commerce mondial, l’abaissement des barrières tarifaires, la réduction des prix des biens de consommation et l’ouverture de nouveaux marchés et champs d’investissement dans les pays dominés par l’impérialisme.
Aujourd’hui, tous ces facteurs se sont transformés en leur contraire. L’expansion du crédit et des liquidités s’est transformée en une montagne de dettes.
La mondialisation (l’expansion du commerce mondial) a été l’un des principaux moteurs de la croissance économique pendant toute une période après l’effondrement du stalinisme en Russie et la restauration du capitalisme en Chine et son intégration dans l’économie mondiale. Au lieu de cela, nous avons aujourd’hui des barrières tarifaires et des guerres commerciales entre les principaux blocs économiques (Chine, UE et Etats-Unis), chacun essayant de sauver son économie aux dépens des autres.
En 1991, le commerce mondial représentait 35 % du PIB mondial, un chiffre qui était resté pratiquement inchangé depuis 1974. Il a ensuite entamé une période de forte croissance pour atteindre un pic de 61 % en 2008. Depuis, il stagne.
Avant la récente vague de droits de douane, le FMI prévoyait que le commerce mondial ne croîtrait que de 3,2 % par an à moyen terme, un rythme bien inférieur à son taux de croissance annuel moyen de 4,9 % pour la période 2000-2019. L’expansion du commerce mondial n’est plus un moteur de la croissance économique comme par le passé. Aujourd’hui, le processus s’est inversé.
La tendance au protectionnisme, symptôme de la crise du capitalisme, s’est développée pendant un certain temps. En 2023, les gouvernements du monde entier ont introduit 2500 mesures protectionnistes (incitations fiscales, subventions ciblées et restrictions commerciales), soit trois fois plus que cinq ans auparavant.
Au cours de la première présidence Trump, les Etats-Unis ont adopté une position protectionniste agressive, non seulement contre la Chine, mais aussi contre l’UE, une politique qui s’est poursuivie sous Biden. Ce dernier a promulgué une série de lois (CHIPS, la soi-disant Loi de réduction de l’inflation, etc.) et de mesures visant à favoriser la production américaine au détriment des importations en provenance du reste du monde. Depuis la réélection de Donald Trump, toutes les tendances au protectionnisme se sont fortement accélérées et ont désormais conduit à une guerre commerciale ouverte.
La montée du protectionnisme et la mise en place de tarifs douaniers vont représenter un nouveau choc pour l’économie mondiale, après la pandémie et la guerre en Ukraine. Cela s’ajoutera aux pressions inflationnistes persistantes dans l’économie – en plus du financement du déficit, des dépenses militaires, des changements démographiques et du changement climatique – tout en sapant la demande.
Cependant, la situation économique est très précaire. Il est possible qu’un nouvel effondrement se produise au cours de la période à venir, et même une dépression n’est pas exclue.
Les tarifs douaniers de Trump

Le virage brutal de Trump vers le protectionnisme et la guerre commerciale ouverte avec la Chine est un symptôme de la crise du capitalisme américain. Cela signifie qu’il faut reconnaître que les entreprises manufacturières américaines ne peuvent pas être compétitives sur le marché mondial sans l’intervention de l’Etat. Dans le même temps, le protectionnisme est un moyen pour les pays capitalistes rivaux de faire payer à d’autres pays le prix de la crise. « L’Amérique d’abord » signifie nécessairement « tous les autres en dernier ».
Avec ses mesures protectionnistes de grande ampleur, Trump poursuit plusieurs objectifs : 1) Pénaliser l’importation de produits manufacturés et donc rapatrier des emplois industriels aux Etats-Unis. 2) Stopper la montée en puissance de la Chine en tant que rival économique. 3) Utiliser le produit des droits de douane pour réduire le déficit budgétaire des Etats-Unis, afin de pouvoir conserver les réductions d’impôts. 4) Utiliser les droits de douane comme monnaie d’échange dans les négociations avec d’autres pays afin d’obtenir des concessions politiques et économiques.
Il est vrai que certaines entreprises ont annoncé des investissements aux Etats-Unis afin de contourner les droits de douane et de conserver leur accès au marché américain (le plus grand marché de consommation au monde). Mais l’installation de nouvelles usines est un processus qui prendra du temps et tout gain en termes de création d’emplois sera probablement compensé par l’impact à court terme des droits de douane sur les chaînes d’approvisionnement.
Aujourd’hui, après 30 ans de mondialisation, les chaînes d’approvisionnement sont extrêmement longues. Différents pays se spécialisant dans différentes parties du processus de production. L’industrie automobile aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada est extrêmement intégrée, les pièces traversant plusieurs fois les frontières avant d’être assemblées par étapes dans différents pays. Toute mesure visant à raccourcir les chaînes d’approvisionnement aura un impact perturbateur immédiat sur l’économie, ce qui entraînera une augmentation du prix des produits, voire leur raréfaction dans certains cas. L’incertitude créée par l’utilisation des droits de douane comme outil de négociation par Trump a également un impact négatif sur les décisions d’investissement.
Les économies américaine et chinoise sont profondément imbriquées et dépendent l’une de l’autre. Pour les Etats-Unis, il n’existe actuellement aucun substitut viable à la fabrication chinoise – les produits chinois sont à la fois abordables et de grande qualité. Les efforts visant à les exclure du marché américain, comme le souhaite Trump, infligeraient probablement de graves dommages économiques bien avant que la relance de l’industrie manufacturière américaine ne puisse commencer, si elle se matérialise un jour.
Toute tentative de mettre fin à cette imbrication aura des conséquences négatives pour l’ensemble de l’économie mondiale. Rappelons qu’après 1929, c’est un tournant protectionniste généralisé qui a fait basculer le monde de la récession économique à la dépression. Le volume du commerce mondial a chuté de 25 % entre 1929 et 1933 et une grande partie de cette baisse est le résultat direct de l’augmentation des barrières commerciales.
Pendant toute une période, la mondialisation a permis au système capitaliste de dépasser partiellement et temporairement les limites de l’Etat-nation. Le protectionnisme représente une tentative de ramener les forces productives dans les limites étroites de l’Etat-nation, afin de réaffirmer la domination de l’impérialisme américain sur les autres. Comme Trotsky l’expliquait dans les années 1930 :
« Des deux côtés de l’Atlantique, on gaspille beaucoup d’énergie mentale à tenter de résoudre le problème fantastique qui consiste à faire rentrer le crocodile dans l’œuf de poule. Le nationalisme économique ultramoderne est irrévocablement condamné par son propre caractère réactionnaire ; il retarde et abaisse les forces productives de l’homme ». (Nationalisme et vie économique, 1934)
Comme on pouvait s’y attendre, les dirigeants syndicaux du monde entier réagissent au protectionnisme en se rangeant derrière leurs propres classes dirigeantes pour « défendre l’emploi » dans leur propre pays. Les communistes doivent défendre un point de vue internationaliste et indépendant de la classe. L’ennemi de la classe ouvrière est la classe dirigeante, avant tout la nôtre, et non les travailleurs des autres pays.
Face aux fermetures d’usines, nous devons promouvoir le slogan de l’occupation. Au lieu d’un nouveau renflouement des entreprises privées par l’Etat, nous exigeons l’ouverture des livres de comptes et la nationalisation sous le contrôle des travailleurs. Si les usines ne sont pas rentables dans le cadre du capitalisme, elles doivent être expropriées, rééquipées et réaffectées à des fins socialement utiles, dans le cadre d’un plan de production établi démocratiquement. Ni le libre-échange ni le protectionnisme ne défendent les intérêts de la classe ouvrière. Il s’agit simplement de deux politiques économiques différentes par lesquelles la classe dirigeante tente de gérer les crises du capitalisme. Notre alternative est de renverser le système qui en est la cause.
Crise de légitimité des institutions bourgeoises
La crise du capitalisme, en tant que système économique incapable de développer les forces productives de manière significative et, par conséquent, d’améliorer le niveau de vie d’une génération à l’autre, a entraîné une crise de légitimité profonde et croissante de toutes les institutions politiques bourgeoises.
On assiste à une polarisation obscène des richesses, avec une petite poignée de milliardaires qui augmentent leurs avoirs, tandis qu’un nombre croissant de travailleurs ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et sont confrontés à des politiques d’austérité, au grignotage du pouvoir d’achat des salaires par l’inflation, à l’augmentation des factures d’énergie, à la crise du logement, etc.
Les médias, les politiciens, les partis politiques établis, les parlements, le système judiciaire, tous sont perçus comme représentant les intérêts d’une petite élite privilégiée, prenant des décisions pour défendre leurs propres intérêts égoïstes étroits plutôt que de servir les besoins du plus grand nombre.
C’est extrêmement important car, en temps normal, la classe dirigeante gouverne par l’intermédiaire de ces institutions, qui sont généralement acceptées et considérées comme représentant « la volonté de la majorité ». Aujourd’hui, cette volonté est remise en question par des couches de plus en plus nombreuses de la société.
Plutôt que le mécanisme normal de la démocratie bourgeoise, qui sert à atténuer les contradictions de classe, l’idée qu’il faut passer directement à l’action pour atteindre ses objectifs est de plus en plus acceptée. En France, un article du journal Le Monde a averti Macron qu’en empêchant le parti ayant le plus de parlementaires élus de former un gouvernement, il risquait que le peuple en tire la conclusion que les élections ne servaient à rien. Aux Etats-Unis, une personne sur quatre pense que la violence politique peut être justifiée pour « sauver » le pays, contre 15 % un an plus tôt.
La montée des démagogues anti-establishment est une indication de cette érosion de la légitimité de la démocratie bourgeoise et de ses institutions. Auparavant, lorsqu’un gouvernement de droite était discrédité, il était remplacé par un gouvernement de « gauche » social-démocrate, et lorsque ce dernier était discrédité à son tour, il était remplacé par un gouvernement conservateur. Ce n’est plus un processus automatique.
Au lieu de cela, on assiste à de violentes oscillations vers la gauche et la droite, que les médias qualifient de croissance de « l’extrémisme politique ». Mais le renforcement des extrêmes en politique n’est qu’une expression du processus de polarisation sociale et politique, qui est à son tour le reflet d’une intensification de la lutte des classes. L’effondrement du centre politique qui en résulte remplit la classe dirigeante de terreur. Elle souhaite l’arrêter par tous les moyens à sa disposition, mais elle est impuissante.
Ce n’est pas difficile à comprendre. Aujourd’hui, les gouvernements de gauche et de droite mènent essentiellement les mêmes politiques de coupes et d’austérité. Cela conduit à un discrédit général de la politique, à une augmentation constante de l’abstention et à l’émergence de toutes sortes de tiers partis, souvent de nature éphémère. Les démagogues de droite ont pu capitaliser sur l’humeur anti-establishment existante, notamment en raison de l’incapacité de la « gauche » officielle à proposer une véritable alternative.

Les cris et les hurlements de l’establishment libéral capitaliste à propos du « danger du fascisme » et de la « menace de l’extrême droite » servent à justifier le soutien au moindre mal, à l’idée que « nous devons tous nous unir pour défendre la démocratie », que nous devrions « défendre la République ». Et ce, alors que dans la plupart des pays, ce sont les libéraux qui sont au pouvoir, s’attaquent à la classe ouvrière, attisent le militarisme… et s’attaquant aux droits démocratiques.
Trump est qualifié de « fasciste » ou d’« autoritaire » lorsqu’il poursuit une politique d’expulsion d’étrangers pour leur soutien à la Palestine. Comment qualifier alors les gouvernements des pays européens qui ont interdit et brutalement réprimé les manifestations pro-palestiniennes ? Comment qualifier le fait qu’en Allemagne et en France, des non-citoyens soient arrêtés et expulsés pour avoir soutenu la Palestine ?
Les libéraux utilisent les tribunaux pour mettre en œuvre des mesures totalement antidémocratiques afin d’empêcher les politiciens qu’ils n’aiment pas de se présenter aux élections (comme Le Pen en France) ou, comme dans le cas de la Roumanie, d’annuler les élections lorsqu’ils n’en aiment pas le résultat ! Ensuite, ils font volte-face et appellent à « l’unité pour défendre la démocratie » et à un « cordon sanitaire contre l’extrême droite ».
C’est une politique criminelle, qui ne fait que renforcer les démagogues de droite. Ceux-ci peuvent alors dire : « Vous voyez, la droite et la gauche, c’est du pareil au même ».
Les communistes combattront toute mesure réactionnaire contre les intérêts de la classe ouvrière et contre les droits démocratiques, mais il serait fatal pour nous d’être perçu comme soutenant la « démocratie » en général (ce qui signifie le soutien à l’Etat capitaliste) ou de mêler nos bannières à celles des libéraux lorsqu’ils attaquent les démagogues de droite.
En réalité, l’attrait des démagogues de droite révélera toujours son caractère illusoire dès qu’il entrera en conflit avec la situation réelle. Trump est déjà au pouvoir aux Etats-Unis. Il a fait de nombreuses promesses. Il surfe sur les attentes de millions de personnes qui pensent qu’il va vraiment « rendre à l’Amérique sa grandeur ». Mais il s’agit d’une pure illusion. Pour les classes populaires, rendre à l’Amérique sa grandeur signifie des emplois décents et bien rémunérés. Cela signifie qu’ils peuvent arriver à la fin du mois sans être obligés pour joindre les deux bouts d’avoir deux ou trois emplois différents ou de vendre du plasma sanguin.
Des millions de personnes aux Etats-Unis s’imaginent que Trump ramènera le « bon vieux temps » de l’après-guerre. S’il y a une chose qui est certaine, c’est que cela n’arrivera pas. La crise du capitalisme exclut aujourd’hui tout retour à l’âge d’or du boom de l’après-guerre ou des années folles.
Il n’est pas exclu que, pendant une courte période, certaines de ces mesures – par exemple, les droits de douane qui favorisent le développement industriel aux Etats-Unis au détriment d’autres pays – aient un léger impact. Beaucoup accorderont également à Trump le bénéfice du doute pendant un certain temps. Il peut également utiliser l’argument selon lequel c’est l’establishment, l’« Etat profond », qui ne lui permet pas de mener à bien ses politiques.
Mais une fois que la réalité s’imposera et que ces illusions seront dissipées, la profonde colère contre l’establishment qui a propulsé Trump au pouvoir conduira à un changement radical vers le côté opposé de l’échiquier politique. Nous pourrions assister à un mouvement de balancier tout aussi brutal et violent vers la gauche.
Il existe un article de Trotsky intitulé Si l’Amérique devait devenir communiste, dans lequel il parle du tempérament américain qu’il décrit comme « énergique et violent » : « Il serait contraire à la tradition américaine de procéder à un changement majeur sans choisir un camp et sans briser quelques crânes. »
Le travailleur américain est pratique et exige des résultats concrets. Il est prêt à agir pour faire avancer les choses. Farrell Dobbs, le leader de la grande grève des Teamsters de Minneapolis en 1934, est passé directement du statut de sympathisant républicain à celui de dirigeant trotskiste. Dans son récit de la grève, il explique les raisons de sa transformation. Pour lui, les trotskistes étaient ceux qui offraient les solutions les plus pratiques et les plus efficaces pour résoudre les problèmes auxquels les travailleurs étaient confrontés.
Une situation explosive : la radicalisation de la jeunesse
La vérité est que la situation mondiale est grosse d’un potentiel révolutionnaire. La vague insurrectionnelle de 2019-2020 a été partiellement interrompue par les confinements de la pandémie de COVID-19, mais les conditions qui l’ont déclenchée sont toujours là. En 2022, le soulèvement au Sri Lanka a fait tomber le président et les masses ont envahi le palais présidentiel. En 2023, les grèves de masse contre la contre-réforme des retraites en France ont mis le gouvernement dos au mur. En 2024, au Kenya, les masses, emmenées par la jeunesse révolutionnaire, ont pris d’assaut le parlement et forcé le retrait du projet de loi de finances. Au Bangladesh, un mouvement de la jeunesse étudiante, confronté à une répression brutale, a conduit à un soulèvement national et au renversement du régime détesté de Hasina.
La caractéristique commune à tous ces mouvements est le rôle prépondérant joué par la jeunesse. Toute personne de moins de 30 ans a vécu toute sa vie politiquement consciente dans une situation marquée par la crise de 2008, la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et le massacre de Gaza.
Plus récemment, nous avons assisté à d’importants mouvements de masse en Turquie, en Serbie et en Grèce. Dans le cas de la Grèce, la rage contre la dissimulation de la catastrophe ferroviaire de Tempi, combinée à la colère accumulée face à l’appauvrissement massif résultant de l’austérité permanente et de l’impasse profonde du capitalisme grec, a conduit à une grève générale massive et aux plus grandes manifestations de protestation dans le pays depuis la chute de la dictature. Le caractère massif de la grève générale, qui a impliqué non seulement la classe ouvrière mais aussi d’autres couches de la société (petits commerçants, etc.), montre le véritable équilibre des forces dans la société capitaliste moderne. Lorsque la classe ouvrière se met en mouvement, elle peut entraîner derrière elle toutes les couches opprimées.
En Serbie, le mouvement de protestation contre l’effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad a déclenché une crise révolutionnaire, avec la plus grande manifestation de protestation de l’histoire du pays. Les étudiants ont joué un rôle décisif, en occupant les universités et en organisant des plénums (assemblées) d’étudiants. Les manifestations ont fait tomber le gouvernement. Les étudiants tentent consciemment d’étendre le mouvement à la classe ouvrière et à l’ensemble de la population en formant des zborovi, des assemblées de masse dans les villes et sur certains lieux de travail.
Ces deux mouvements mettent en évidence deux caractéristiques essentielles de la situation actuelle : l’énorme pouvoir potentiel de la classe ouvrière et son poids social dominant, d’une part, et l’extrême faiblesse du facteur subjectif, d’autre part.
En outre, des couches de la jeunesse se sont également radicalisées sur la question des droits démocratiques, à travers le mouvement de masse des femmes contre la violence et la discrimination (Mexique, Espagne), en faveur ou en défense du droit à l’avortement (Argentine, Chili, Irlande, Pologne), pour le mariage homosexuel (Irlande), le mouvement de masse contre les brutalités policières à l’encontre des Noirs (Etats-Unis et Grande-Bretagne), etc.
La crise climatique est également devenue un facteur de radicalisation pour cette génération de jeunes qui sont convaincus – à raison – que si les choses ne changent pas radicalement, la vie sur Terre est menacée et que c’est le système qui est responsable de cette situation.
L’hypocrisie et le double langage de l’impérialisme concernant le massacre de Gaza, le soi-disant « Droit international » et la répression policière du mouvement de solidarité avec la Palestine leur ont ouvert les yeux sur la nature de l’Etat capitaliste, des médias capitalistes et des institutions internationales.
Une partie croissante de la jeunesse s’identifie aux idées communistes comme l’alternative la plus radicale contre le système capitaliste. Il ne s’agit pas d’une majorité, pas même parmi les jeunes, mais il s’agit certainement d’une évolution significative.
L’effondrement du stalinisme a eu lieu il y a 35 ans, de sorte que pour cette génération, la propagande de la classe dirigeante sur « l’échec du socialisme » n’a que très peu de sens. Ce qui les préoccupe et ce dont ils ont souffert directement, c’est l’échec du capitalisme !

Crise de direction
Il y a une accumulation de matériaux combustibles dans le monde entier. La crise du système capitaliste dans toutes ses manifestations a provoqué un soulèvement révolutionnaire après l’autre. Le soi-disant ordre mondial libéral, qui a façonné le monde pendant des décennies, s’effondre sous nos yeux. Le tournant vers le protectionnisme et les guerres commerciales crée d’énormes turbulences économiques.
La question que nous devons nous poser n’est pas de savoir s’il y aura des mouvements révolutionnaires dans la période qui s’ouvre devant nous. C’est certain. La question est de savoir si ces mouvements aboutiront à une victoire de la classe ouvrière.
Nous avons assisté à un certain nombre de mouvements révolutionnaires et d’insurrections au cours des 15 dernières années. Ils ont démontré l’énorme élan révolutionnaire et le pouvoir des masses une fois qu’elles se sont mises en mouvement. Elles ont été capables de surmonter la répression brutale, l’état d’urgence, les coupures d’information et les régimes les plus répressifs. Mais, en fin de compte, aucun d’entre eux n’a conduit la classe ouvrière au pouvoir.
Ce qui a manqué, à chaque fois, c’est une direction révolutionnaire capable de mener le mouvement à sa conclusion logique. La révolution arabe de 2011 s’est soldée par des régimes bonapartistes répressifs (Egypte, Tunisie) ou, pire encore, par des guerres civiles réactionnaires (Libye et Syrie). Le soulèvement chilien a été détourné dans les eaux sûres du constitutionnalisme bourgeois. La révolution soudanaise s’est également terminée par une guerre civile totalement réactionnaire.
Trotsky a écrit dans le Programme de transition que « la crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire ». Ses paroles sont aujourd’hui plus vraies que jamais. Le facteur subjectif – c’est-à-dire une organisation de cadres révolutionnaires enracinés dans la classe ouvrière – est extrêmement faible par rapport aux tâches colossales posées par l’histoire. Depuis des décennies, nous luttons à contre-courant et sommes rejetés par de puissants courants objectifs.
Cela signifie inévitablement que les crises révolutionnaires à venir ne seront pas résolues à court terme. Nous sommes donc confrontés à une longue période de hauts et de bas, d’avancées et de défaites. Mais à travers tous ces processus, la classe ouvrière apprendra et son avant-garde se renforcera. La marée de l’histoire commence enfin à couler dans notre sens et nous pouvons nager avec le courant, plutôt que contre lui.
Notre tâche est de participer, aux côtés des masses de la classe ouvrière, et de relier le programme achevé de la révolution socialiste aux aspirations embryonnaires des éléments les plus avancés à un changement révolutionnaire fondamental.
La fondation de l’Internationale communiste révolutionnaire en 2024 a été une étape très importante et nous ne devrions pas sous-estimer ce que nous avons réalisé : une organisation internationale fermement basée sur la théorie marxiste. Au cours de la période récente, nos effectifs ont augmenté de manière significative. Néanmoins, nous devons garder le sens des proportions : nos forces sont encore tout à fait insuffisantes par rapport aux tâches qui nous attendent.
La faiblesse du facteur subjectif signifie inévitablement qu’au cours de la prochaine période, la radicalisation des masses s’exprimera par la montée et la chute de nouvelles formations et de nouveaux dirigeants réformistes de gauche. Certains d’entre eux pourraient même utiliser un langage très radical, mais tous se heurteront aux limites fondamentales du réformisme : leur incapacité à poser la question fondamentale du renversement du système capitaliste et de la prise du pouvoir par la classe ouvrière. C’est pourquoi la trahison est inhérente au réformisme. Mais pendant un certain temps, certaines de ces formations et certains de ces dirigeants susciteront l’enthousiasme et obtiendront le soutien des masses.
Il doit y avoir partout un sentiment d’urgence dans la construction de l’organisation. Ce n’est pas la même chose d’avoir 100, 1000 ou 10 000 membres lorsqu’éclatent des soulèvements de masse. Une organisation de 1000 cadres formés au début de la révolution bolivarienne au Venezuela ou une organisation de 5000 cadres enracinés dans la classe ouvrière lorsque Corbyn a remporté la direction du parti travailliste en Grande-Bretagne auraient pu transformer la situation. À tout le moins, avec une politique et une approche correctes du mouvement des masses, ils auraient pu devenir une force significative au sein de la classe ouvrière, devenant un point de référence pour des couches plus larges.
Dans de bonnes conditions, dans le feu des événements, même une organisation relativement petite peut se transformer en une force beaucoup plus grande et lutter pour conquérir la direction des masses. C’est l’avenir. Notre tâche actuelle est le patient travail de recrutement, et surtout de formation et d’éducation des cadres, en particulier au sein de la classe ouvrière et de la jeunesse étudiante.
Une organisation fermement enracinée dans les masses et armée de la théorie marxiste sera en mesure de répondre rapidement aux changements et virages rapides de la situation. Mais une direction révolutionnaire ne peut être improvisée une fois que les événements révolutionnaires ont éclaté, elle doit être préparée à l’avance. C’est la tâche la plus urgente à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. De notre succès ou de notre échec dépend en fin de compte l’ensemble de la situation. Cette idée doit être le moteur principal de tous nos travaux, sacrifices et efforts. Avec la détermination et la persévérance nécessaires, nous pouvons réussir et nous réussirons.