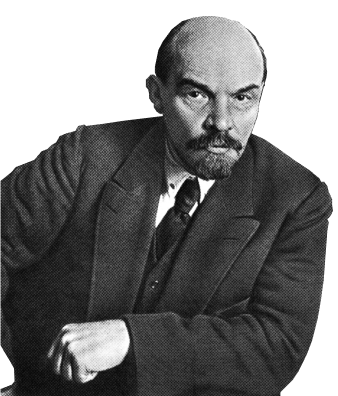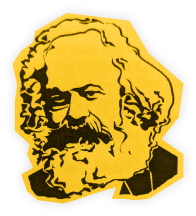Que peut faire le mouvement ouvrier pour contribuer à contrecarrer la machine de guerre israélienne?
Au cours des deux dernières années, de nombreux syndicats canadiens ont rédigé des déclarations condamnant les actions d’Israël à Gaza. Mais alors qu’Israël poursuit sa campagne génocidaire, nombreux sont ceux qui estiment qu’il faut en faire plus.
Les représentants syndicaux affirment qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose, étant si loin de la Palestine. Mais est-ce vrai?
Mais si l’on regarde l’histoire du Canada, on peut voir qu’à certains moments, des travailleurs ont refusé de travailler afin d’entraver les actions d’un régime étranger, et ce, avec des résultats significatifs.
Le 3 juillet 1979 à Saint John, au Nouveau-Brunswick, a été l’un de ces moments. Ce jour-là, les débardeurs de Saint John, soutenus par des syndicats à travers le pays, ont mené une grève illégale qui a interrompu le transport de matériel nucléaire vers le régime argentin de l’époque. Cet évènement, décrit par une publication comme « l’exemple le plus spectaculaire de solidarité syndicale canadienne avec des travailleurs du tiers-monde », mérite d’être étudié comme un exemple positif de travailleurs mettant leur pouvoir au service de la solidarité internationale.
Sale besogne
En 1976, l’armée argentine renverse le gouvernement d’Isabel Perón par un coup d’État soutenu par les États-Unis. S’ensuit une campagne de terreur. Des escadrons de la mort assassinent syndicalistes, socialistes et toute personne considérée comme hostile au nouveau régime et aux élites du monde des affaires proches des États-Unis. Entre 20 000 et 30 000 personnes sont assassinées ou « disparaissent » au cours de ce que l’on a appelé plus tard la « Guerre sale ».
Bien que le gouvernement canadien fasse à l’occasion part de ses « préoccupations » concernant ces atrocités, il n’en fait pas grand cas. Il a déjà vendu à l’Argentine un réacteur nucléaire CANDU en 1973, malgré les soupçons répandus selon lesquels ce pays développe un programme d’armement nucléaire. À l’époque, l’armée argentine est déjà puissante et connue pour ses violations flagrantes des droits de la personne. Ross Campbell, directeur d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), défend l’accord en déclarant que « les affaires sont les affaires et les droits de la personne sont les droits de la personne ».
Le gouvernement canadien continue ces démarches à la fin des années 1970 et envoie une équipe chargée d’étudier la vente d’un deuxième réacteur CANDU.
« Pas de CANDU pour l’Argentine »
Cette décision suscite l’indignation. Pour empêcher la vente des matières nucléaires, des expatriés argentins, des syndicalistes et d’autres militants forment le Comité « No CANDU for Argentina » (NCAC) (« Pas de CANDU pour l’Argentine »). Ils sont soutenus par le Congrès du travail du Canada, la Fédération du travail de l’Ontario (FTO), les Travailleurs unis de l’automobile et les Travailleurs unis de l’électricité.
En septembre 1978, le NCAC découvre qu’un composant important du réacteur CANDU de l’Argentine sera expédié de Saint John l’année suivante.
En réponse, le NCAC fait part de ses objections au ministère canadien des Affaires étrangères. Ne voulant pas compromettre ses relations commerciales avec l’Argentine, le gouvernement canadien refuse de changer de position.
Le NCAC allait devoir prendre les choses en main.
Le NCAC contacte le président du Conseil du travail de Saint John, Larry Hanley, qui l’invite à prendre la parole lors d’une réunion du Conseil. Au cours de cette réunion, Enrique Tabak, membre du NCAC et expatrié argentin, parle aux travailleurs rassemblés des horreurs commises en Argentine, de la persécution des syndicalistes et de la complicité du gouvernement canadien. Il reçoit une ovation et le Conseil s’engage à soutenir la campagne pour stopper la cargaison.
Le Conseil du travail de Saint John publie une déclaration dénonçant la livraison prévue et le soutien du gouvernement canadien « à une junte militaire répressive ». Il demande également aux débardeurs de Saint John de coopérer avec le NCAC. Ce sont ces travailleurs, membres du local 273 de l’Association internationale des débardeurs (AID), qui devaient charger la cargaison à destination de l’Argentine.
Le soutien du Conseil du travail ne se limite pas à la publication de déclarations. Ses membres se renseignent activement sur les mouvements prévus et le contenu des cargaisons en partance du port de Saint John, et fournissent ces informations au NCAC et aux syndicats qui le soutiennent. La FTO distribue de la documentation à ses membres et demande des télégrammes en soutien à l’action prévue.
Le pouvoir des travailleurs
Au milieu de l’année 1979, le NCAC connait le contenu et la date de la livraison. Le contenu : de l’eau lourde d’une valeur de 45 millions de dollars (en monnaie de 1979), essentielle au fonctionnement des réacteurs nucléaires. La date : le 3 juillet 1979.
Le NCAC décide de former un piquet d’information à l’extérieur du port et de retenir la cargaison. Ses objectifs sont de montrer au gouvernement canadien qu’il serait coûteux de faire des affaires avec le régime argentin, et d’inciter d’autres travailleurs à entreprendre des actions similaires.
En amont, les militants du NCAC prennent la parole lors de réunions syndicales dans tout le Canada, pour obtenir davantage de soutien. Le 3 juillet, le NCAC avait reçu l’appui de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB), de la Fédération des travailleurs de la marine, de la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, et de nombreuses autres organisations.
Le message aux débardeurs de Saint John est clair : le mouvement syndical est derrière vous.
Mais les déclarations, bien qu’importantes, ne restent que des bouts de papier. Au bout du compte, la cargaison ne pouvait être bloquée que par les débardeurs eux-mêmes. Pas une roue ne tourne, pas une ampoule ne brille, pas une cargaison ne prend la mer sans la gentille permission de la classe ouvrière.
Dès que les plans du NCAC sont rendus publics, les débardeurs subissent d’énormes pressions pour ne pas y prendre part. Les journaux publient des articles soulignant que le refus de charger les marchandises constituerait une « grève illégale » et évoquent la menace d’amendes, de mesures disciplinaires et d’une perte de salaire.
Face à cette pression, les dirigeants du local 273 de l’AID plient. L’agent de liaison du syndicat s’oppose ouvertement au débrayage, tandis que le secrétaire du syndicat déclare que les débardeurs n’ont « pas d’autre choix que d’honorer notre convention collective ». Malgré le fait que le NCAC a contacté la section locale dès le début, tout indique que les dirigeants ont refusé de communiquer les plans et les objectifs du 3 juillet à leurs membres.
C’est plutôt un débardeur de la base, Jimmy Orr, qui contribue à convaincre ses collègues de l’importance de la solidarité internationale et de la nécessité de refuser de travailler le 3 juillet. Il décrit le sentiment qui l’animait, lui et ses pairs, à la veille de cette journée :
« Nous avions quelques dissidents, mais ils étaient nettement minoritaires. La grande majorité de la section locale soutenait l’action, vous savez, elle comprenait la situation. »
Sans les efforts cruciaux de travailleurs comme Orr au sein de la section locale, l’ensemble de l’action aurait fini en queue de poisson.
« No Hot Cargo »
Au petit matin du 3 juillet, le NCAC dresse un piquet de grève devant le port de Saint John. Les membres du Comité portent des macarons jaune vif « Hot Cargo » (« article interdit ») et de la documentation sur la junte en Argentine. Ils viennent également avec des demandes supplémentaires : la libération de 17 prisonniers politiques, pour la plupart des syndicalistes, qui croupissent dans les prisons argentines.
Peu de temps après, les premiers débardeurs se présentent au port pour travailler. Les militants de la NCAC les approchent immédiatement pour leur expliquer leur action et la répression des syndicalistes en Argentine. Le président du Conseil du travail, Larry Hanley, implore ses collègues syndicalistes à ne pas traverser la ligne.
Incroyablement, malgré les ordres de leurs dirigeants syndicaux locaux, malgré la menace d’amendes et de perte de salaire, les travailleurs refusent de traverser. Ils prennent des macarons « Hot Cargo » pour les porter et des autocollants pour identifier la cargaison elle-même.
Les débardeurs en sont venus à considérer la lutte des travailleurs argentins comme la leur, en partie grâce aux efforts du NCAC. La persécution des syndicalistes en Argentine était une attaque contre les syndicalistes du monde entier. Il s’agissait de mettre en action leur solidarité de classe internationale.
Les actions des membres de la base du local 273 convainquent les quelques travailleurs restants du port, également membres du syndicat, de les rejoindre dans la grève. Le port de Saint John est totalement fermé pendant une période de 12 heures.
Bien que la grève ait été de courte durée, elle représentait un grand pas en avant. Au lieu de se contenter d’en appeler aux politiciens, les travailleurs ont pris eux-mêmes des mesures concrètes.
Cela a également créé un précédent : on avait rarement vu de grèves illégales pour des motifs de solidarité internationale dans l’histoire du Canada à l’époque.
Les fruits de la victoire
Au cours de la journée du 3 juillet, le NCAC reçoit une multitude de télégrammes de soutien de la part d’autres syndicats exprimant leur volonté à passer à l’action. Parmi eux, les débardeurs de Vancouver s’engagent à refuser de charger toute cargaison potentiellement meurtrière à destination de l’Argentine. Les travailleurs du port de Saint John avaient donné l’exemple.
Un vent de panique souffle sur Ottawa et Buenos Aires. La ministre canadienne des Affaires étrangères, qui a d’abord ignoré le NCAC, s’engage à faire part des préoccupations du NCAC au régime argentin. Le 5 juillet, deux jours seulement après la grève, on apprend que l’un des 17 prisonniers politiques a reçu un visa pour venir au Canada. Le 13 juillet, on apprend que 11 autres prisonniers ont été libérés, et que trois autres ont été libérés, mais envoyés en exil. La grève a porté ses fruits.
Ce petit événement montre l’immense pouvoir que la classe ouvrière détient entre ses mains. Combien de fois les travailleurs ont-ils adressé des demandes au gouvernement, pour ensuite être ignorés? Le fait est que le gouvernement canadien et la classe dirigeante au sens large craignaient que l’exemple des débardeurs de Saint John ne se répande. Avec la montée du militantisme ouvrier tout au long des années 1970, la dernière chose dont ils avaient besoin était que les travailleurs portuaires arrêtent les livraisons.
L’exemple de Saint John a également établi une tradition. En 1982, une autre décision sur les articles interdits a été adoptée pour empêcher d’autres livraisons de combustibles nucléaires à l’Argentine. À cette occasion, les présidents de la section locale 273 et de la FTTNB ont fait savoir qu’ils étaient prêts à aller en prison plutôt que de manutentionner la cargaison.
En 2003, la section locale 273 a émis un autre décret contre toute expédition à destination de l’Irak en signe de protestation contre l’invasion américaine. En 2018, les débardeurs de Saint John ont de nouveau été accueillis par un piquet d’information visant à empêcher le transport de véhicules militaires vers l’Arabie saoudite – et une fois de plus, ils ont refusé de traverser.
Plus récemment, en juin 2025, la FTTNB a émis un décret désignant le matériel militaire à destination d’Israël comme article interdit, en signe de protestation contre le génocide en cours. Au Nouveau-Brunswick, l’héritage de 1979 continue de se transmettre.