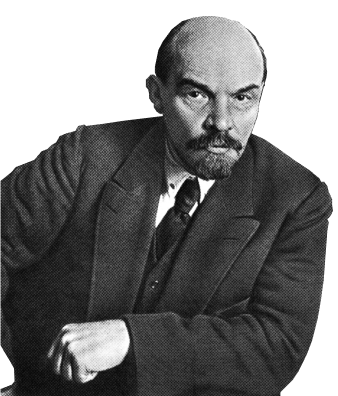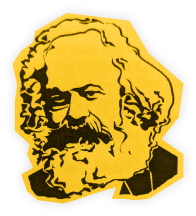La mort : l’engrenage de la chaîne, l’imperturbable glissement des voitures, la répétition de gestes identiques, la tâche jamais achevée. Une voiture est-elle faite? La suivante ne l’est pas, et elle a déjà pris la place, dessoudée précisément là où on vient de souder, rugueuse précisément à l’endroit que l’on vient de polir. Faite, la soudure? Non, à faire. Faite pour de bon, cette fois-ci? Non, à faire à nouveau, toujours à faire, jamais faite — comme s’il n’y avait plus de mouvement, ni d’effet des gestes, ni de changement, mais seulement un simulacre absurde de travail, qui se déferait aussitôt achevé sous l’effet de quelque malédiction. Et si l’on se disait que rien n’a aucune importance, qu’il suffit de s’habituer à faire les mêmes gestes d’une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en n’aspirant plus qu’à la perfection placide de la machine? Tentation de la mort. Mais la vie se rebiffe et résiste. L’organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. Quelque chose, dans le corps et dans la tête, s’arc-boute contre la répétition et le néant.
La vie : un geste plus rapide, un bras qui retombe à contretemps, un pas plus lent, une bouffée d’irrégularité, un faux mouvement, la « remontée », le « coulage », la tactique de poste; tout ce par quoi, dans ce dérisoire carré de résistance contre l’éternité vide qu’est le poste de travail, il y a encore des événements, même minuscules, il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, cette main qui s’y reprend à deux fois, cette grimace, ce « décrochage », c’est la vie qui s’accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement : « Je ne suis pas une machine! »
Dans L’établi (1978), Robert Linhart raconte son expérience comme ouvrier sur une chaîne de montage dans une grande usine de voitures Citroën en 1968-1969. Ce militant avait fait comme de nombreux autres maoïstes français faisant parti du mouvement des « établis » – des intellectuels ayant « infiltré » les milieux ouvriers.
Mais il ne s’agit pas simplement d’une description naïve par un intellectuel ébahi de ce qui est banal pour un travailleur. Linhart raconte de façon passionnante et parfois poétique la vie d’un ouvrier dans un contexte bien particulier – celui de la France post-Mai 68. Et ce qui rend L’établi particulièrement intéressant est que Linhart, grâce à son éducation marxiste (malgré qu’il s’agisse de la version bâtarde que constitue le maoïsme), sait observer et détailler la condition ouvrière avec beaucoup d’intelligence et de discernement.
Notamment, la description qu’il fait du travail à la chaîne (cité au début de ce texte) et de l’aliénation qu’elle produit chez le travailleur fait écho à ce que Marx explique dans le Capital : « Dans la manufacture et le métier, l’ouvrier se sert de son outil; dans la fabrique il sert la machine. Là le mouvement de l’instrument de travail part de lui; ici il ne fait que le suivre. Dans la manufacture les ouvriers forment autant de membres d’un mécanisme vivant. Dans la fabrique ils sont incorporés à un mécanisme mort qui existe indépendamment d’eux.»
Linhart donne une forme très concrète à la lutte des classes sous le capitalisme, que Marx décrivait comme la lutte pour le partage de la plus-value. Les patrons et les travailleurs sont constamment en train de se tirailler pour gruger une minute ici, une minute là : les travailleurs remportent une victoire lorsqu’ils prennent la pause une minute plus tôt; les patrons poussent les employés au bout de leurs forces, jusqu’à se blesser, pour gagner quelques secondes sur la production d’une voiture.
Lorsque la direction de l’usine de Citroën annonce qu’elle reprendra une partie des concessions faites aux ouvriers en mai 1968 (les fameux « accords de Grenelle ») en allongeant la journée de travail, Linhart participe à organiser une grève. Le récit qu’il fait de la grève est captivant et riche en enseignements. Il explique comment les particularités de chaque corps de métiers affecte leur attitude face à la grève, la psychologie des travailleurs et l’effet de leurs conditions de vie individuelles, ainsi que la dynamique de la psychologie des masses.
Linhart détaille de façon pénétrante les méthodes de la direction pour casser la grève, contrôler les travailleurs et les maintenir dans l’exploitation : le recours au poison du racisme pour garder les travailleurs divisés, les menaces sur le statut d’immigré, les manigances avec le syndicat jaune à la botte du patron, les méthodes d’intimidation et de démoralisation dignes d’une mafia, etc.
Il y en aurait beaucoup à dire. L’établi est un petit livre dense et riche. Je ne peux que vous conseiller de le lire.