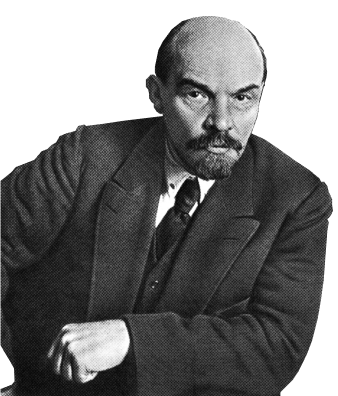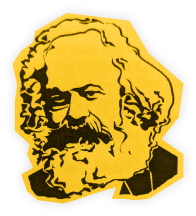« Il n’y a pas de capitalisme sans racisme. » Ces simples paroles ont été prononcées dans un discours en 1964 par le grand martyr révolutionnaire Malcolm X. Plus de 60 ans plus tard, elles sont aussi vraies que le jour où elles ont été prononcées.
Officiellement, nous vivons dans une démocratie où tous ont accès à l’égalité des chances et où la discrimination raciale est interdite par la loi. La vérité est bien plus sombre. Loin d’être un héritage malheureux d’un passé barbare, le racisme systémique non seulement perdure, mais prospère. On retrouve partout les traces de ce fléau.
Les travailleurs immigrés et racisés sont parmi les plus mal payés et les plus exploités de la société. Ils sont surreprésentés dans les emplois temporaires, contractuels ou à temps partiel, sont plus susceptibles d’être au chômage que les Blancs et sont confrontés à des niveaux plus élevés de pauvreté, d’insécurité alimentaire et de maladie.
Ils sont également pris pour cibles par la violence raciste de l’État. À Toronto, par exemple, la police est deux fois plus susceptible de recourir à la force contre les Noirs. Pour les Autochtones, la situation est encore pire. Ils ne représentent que 5% de la population générale, mais comptent pour 28% des détenus fédéraux, et ils sont dix fois plus susceptibles d’être abattus par la police que les Blancs.
La manifestation la plus effroyable du racisme au Canada est l’oppression persistante des Autochtones, héritage sanglant des débuts du capitalisme canadien. Aujourd’hui, de nombreux Autochtones vivent dans des conditions comparables à celles d’un pays du tiers-monde, où les logements délabrés, la faim chronique et l’eau impropre à la consommation font partie de la réalité. Ces conditions barbares ont conduit à une épidémie de suicides dans les réserves.
Les politiciens libéraux pleurent des larmes de crocodile et prétendent que le Canada est un pays au passé mouvementé qui évolue lentement vers l’égalité. En réalité, alors que la crise du capitalisme s’intensifie, la classe dirigeante en rajoute. Les libéraux de Carney ont passé les premiers mois de leur mandat à attaquer les immigrés avec le projet de loi C-2, qui prive les migrants et les réfugiés de leur droit à une procédure équitable, ainsi qu’à s’attaquer aux droits territoriaux des Autochtones avec le projet de loi C-5, qui vise à faciliter le pillage des ressources naturelles par les entreprises.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que de puissants mouvements de masse aient vu le jour, comme Idle No More et Black Lives Matter, mobilisant des couches importantes de la jeunesse.
Malgré l’ampleur et la force de ces mouvements, le racisme systémique sévit de plus belle. Comment cela se fait-il? Certains en ont tiré des conclusions pessimistes, estimant que le racisme fait partie de la « nature humaine ».
Ce sentiment est compréhensible, mais il est erroné. Le racisme n’a pas toujours existé et n’existera pas toujours à l’avenir. Mais pour y mettre fin, il faut d’abord bien le comprendre.
Les racines du racisme
Le racisme n’est pas tombé du ciel. Il est produit et influencé par la société dont il est issu.
Le capitalisme est un système fondé sur l’inégalité, l’exploitation et l’oppression. L’écrasante majorité de la population appartient à la classe ouvrière et c’est nous qui créons la richesse de la société par notre travail. Pourtant, la société est dominée par un petit groupe de milliardaires, qui possèdent la majeure partie de cette richesse et en récoltent les fruits, tandis que les autres sont menacés de pauvreté et de famine. Comment cela est-il possible?
Pour que quelques-uns puissent dominer le plus grand nombre, le capitalisme a besoin de l’État : le système juridique, les tribunaux et, surtout, la force, sous la forme de la police et de l’armée. Cependant, les millions d’opprimés sont bien plus nombreux que la classe dirigeante. Un mouvement révolutionnaire uni des masses pourrait renverser tout cet édifice pourri en un instant. Par conséquent, le capitalisme ne peut pas régner uniquement par la force : il a également besoin d’une idéologie qui justifie sa domination et facilite l’exploitation.
Tel est le véritable rôle du racisme. Il justifie l’inégalité et divise les travailleurs selon des critères raciaux. C’est la vieille tactique du « diviser pour mieux régner » : ils veulent que nous nous battions les uns contre les autres pour les miettes qu’ils daignent nous laisser afin que nous ne nous unissions pas et que nous ne luttions pas contre notre véritable ennemi de classe.
Il sert aussi à justifier la tendance du capitalisme à la domination impérialiste et aux guerres. Chaque nouvelle agression impérialiste au Moyen-Orient trouve son corollaire dans une vague d’islamophobie fomentée par les politiciens ici.
Et lorsque le système entre inévitablement en crise, la classe dirigeante dispose d’un bouc émissaire commode pour porter le chapeau. Les politiciens blâment les immigrés pour la détérioration des services sociaux et les accusent de prendre tous les emplois, afin que nous ne placions pas la responsabilité là où elle doit être : les capitalistes et leur système qui crée le chômage et l’austérité.
Un produit du capitalisme
Bien sûr, le racisme n’a rien de nouveau. Mais cela ne signifie pas que le racisme fait simplement partie de la « nature humaine ». Avant le capitalisme, les catégories raciales en utilisation aujourd’hui n’existaient pas. L’idéologie raciale est un produit du capitalisme, et les deux sont nés main dans la main.
La colonisation des Amériques, à partir du XVIe siècle, a constitué un élément essentiel de la montée du capitalisme. Les profits et les ressources naturelles des colonies ont alimenté l’émergence de l’industrie en Europe.
Les colonisateurs ont élaboré de nouvelles idéologies pour justifier leur règne. La « Doctrine de la découverte » formulée par l’Église catholique déclarait les terres non habitées par des chrétiens comme terra nullius, c’est-à-dire des terres n’appartenant à personne, et donc libres d’être découvertes et revendiquées. Les érudits et les ecclésiastiques européens ont créé des théories raciales qui « prouvaient » que les peuples autochtones étaient des sous-hommes, justifiant ainsi les meurtres et les pillages de masse.
Aux États-Unis, le racisme a été utilisé pour fortifier les chaînes de l’esclavage. Au début du XVIIe siècle, les plantations des colonies du Sud étaient cultivées par un mélange d’esclaves blancs et noirs et de serviteurs sous contrat. Toute cette période a été marquée par une lutte des classes intense, avec des soulèvements périodiques qui remettaient en cause le pouvoir de la bourgeoisie naissante. Lors de la plus importante d’entre elles, la rébellion de Bacon de 1676, les esclaves noirs et blancs et les serviteurs sous contrat se sont unis pour lutter contre leurs exploiteurs communs et ont même incendié la capitale de l’État de Virginie. Bien que la rébellion ait échoué, le spectre d’une lutte des classes unie a ébranlé les exploiteurs jusqu’au plus profond d’eux-mêmes. Ils ont fini par accorder un traitement préférentiel aux Blancs, afin de rendre les esclaves plus facilement identifiables, mais aussi dans le but de « diviser pour mieux régner » et d’empêcher de futures rébellions sur le même modèle. Une idéologie raciste en a découlé.
Ces exemples montrent que le racisme n’est pas simplement le produit d’une idéologie abstraite détachée de la réalité matérielle. Le racisme sert les intérêts de la classe dirigeante.
C’est ce qui rend les paroles de Malcolm X si profondes. Il ne peut y avoir de capitalisme antiraciste.
Aujourd’hui, des millions de travailleurs de toutes races sont confrontés aux mêmes problèmes : bas salaires, coût du logement en hausse vertigineuse et endettement écrasant. Si les travailleurs s’unissaient dans une lutte de classe combative, ils pourraient améliorer le niveau de vie de tous et menacer le capitalisme de le renverser. C’est pourquoi la classe dirigeante propage ce poison.
C’est également la raison pour laquelle les communistes luttent – et ont toujours lutté – contre le racisme, ainsi que contre toute autre tentative de diviser la classe ouvrière sur des lignes ethniques, sexuelles, religieuses ou nationales.
Si nous voulons mettre fin au racisme, il ne suffira pas d’apporter des modifications superficielles au système. Nous devons l’arracher à la racine, ce qui signifie une révolution socialiste. Cette révolution privera enfin le racisme des conditions dans lesquelles il se développe et jettera les bases non seulement d’un meilleur niveau de vie pour tous, mais aussi de relations véritablement humaines, exemptes de préjugés, de sectarisme et de haine raciale.